Dans son nouvel essai paru aux éditions Divergences, Alexandre Monnin (1) poursuit en solo les travaux entamés avec ses comparses Emmanuel Bonnet et Diego Landivar dans « Héritage et fermeture ». Un ouvrage pas facile mais intéressant pour penser un avenir avec planète habitable.
Qui doit prendre en charge les ruines ? Ce n’est pas une question pour archéologues que pose Alexandre Monnin. Les ruines dont il est question ici n’ont rien d’antique : elles appartiennent au présent, voire au futur.
Les ruines qui sont le sujet central de son livre « Politiser le renoncement » constituent ce qu’il définit comme des « communs négatifs ». Nous connaissons déjà les biens communs, qu’il est souhaitable de partager équitablement entre toute une communauté ou toute une planète mais que tout le monde peut être tenté de s’accaparer. Alexandre Monnin invite à s’intéresser à leur version négative, dont personne, au contraire, ne veut s’emparer : ce sont les ruines que nous laissent sur les bras, en héritage, la folie des grandeurs d’une humanité ayant cru les ressources infinies « et dont il va bien falloir prendre soin ».
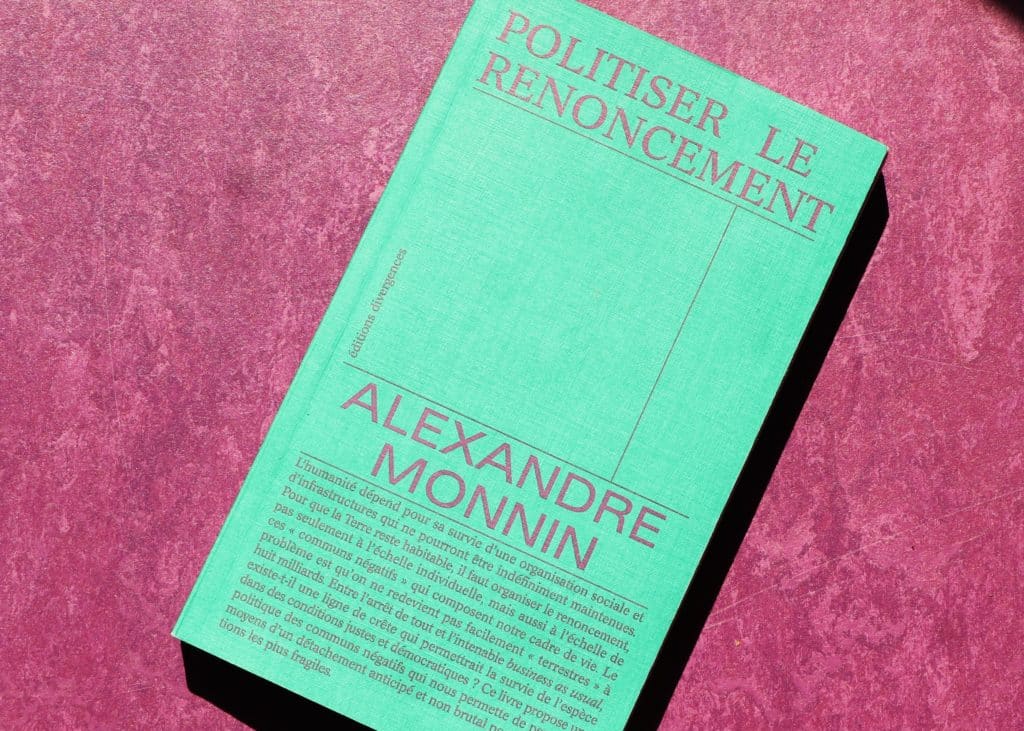
Ruines ruinées et ruines ruineuses
Selon lui, ces ruines sont de deux ordres : les « ruines ruinées » et les « ruines ruineuses ».
Les premières sont faciles à identifier : déchets en tous genres (y compris nucléaires), pollutions à grande échelle, désastres écologiques… en un mot, résume-t-il, les « rebuts devenus inassimilables ».
L’autre catégorie est plus pernicieuse : les ruines ruineuses sont à la fois plus redoutables et plus difficiles à repérer. Car elles sont encore vivantes, ou du moins elles le paraissent. Ce sont toutes les structures, infrastructures et dispositifs qui ont la capacité de produire les ruines ruinées. « Les véritables ruines sont [à chercher] dans les réalités rutilantes, high-tech, dans le régime destructeur de l’innovation intensive à tous crins et l’incessant renouvellement qu’il requiert », écrit l’auteur.
“Le régime destructeur de l’innovation intensive à tous crins.”
Exemples cités dans le livre : « smartphones et 5G, pétrole et énergies fossiles, supply chains, modèles d’attractivité entre territoires, doctrines économiques ou managériales hors sol… » Un fourre-tout que l’auteur lui-même reconnaît hétéroclite, mais qu’il englobe dans une formulation générique : la « Technosphère ».
On n’est pas loin de ce qu’un physicien collègue d’Alexandre Monnin, José Halloy, qualifie pour sa part d’activités « zombies ». Leurs effets mortifères appartiennent éventuellement au présent, mais surtout au futur.
Dimension planétaire
Bref, constate le chercheur clermontois, nous avons tout ça sur les bras et il faut décider de ce qu’on en fait. Et même avant cela, de qui décide de ce qu’on en fait.
Car une fois identifié un commun négatif, on peut décider de « faire avec » ou de « faire sans » ; c’est-à-dire continuer à en tirer profit (pour rouler en voiture, nous éclairer, changer régulièrement de smartphone…) ou d’y renoncer parce que nous avons compris que ce n’était pas viable de continuer à en profiter. Pas viable au moins pour un groupe de personnes présentes ou futures, voire pas viable pour l’humanité entière, pour le vivant ou pour la planète en général. Le point commun des ruines ruineuses, c’est qu’elles rendent la planète toujours plus inhabitable.
« Politiser la situation nécessite d’élargir le public concerné.”
C’est une autre notion qu’Alexandre Monnin pointe : les conséquences désastreuses des ruines ruineuses dont nous héritons ne concernent plus seulement un petit groupe de riverains, de voisins victimes du machin. Nos communs négatifs sont planétaires. La déforestation de l’Amazonie ne concerne pas que les peuples qui y vivent. La guerre en Ukraine n’est pas qu’une ligne de front entre deux nations tout là-bas à l’est. L’extraction du pétrole au Moyen-Orient est une aile de papillon qui sème l’effondrement du vivant sur tous les continents… Et que dire du numérique, gigantesque commun négatif d’échelle planétaire dont personne n’a réellement envie de se passer ?
Qui décide ?
Pour ces raisons, il importe de décider qui en décide. Les « auteurs » des ruines ruineuses ? Difficile de compter sur eux pour décider tout seuls qu’elles ne sont pas viables – à moins qu’ils y soient poussés par des soucis d’image, de règlementation, de retours de bâton… Les « victimes » les plus directes : peuples amazoniens, agriculteurs bengalis, habitants du Marais poitevin ? Ils paraissent déjà plus légitimes en termes de justice sociale, mais trop proches pour appréhender la complexité des enjeux. « Politiser la situation, écrit Alexandre Monnin, nécessite d’élargir le public concerné pour remonter aux causes, déterminer les responsabilités, demander réparation, mettre en place des formes de solidarités, prévenir les récidives, intéresser à une cause, etc. A chacune de ces étapes, les échelles et les acteurs varient. »

Entre en jeu un autre groupe d’acteurs : celui constitué de tous les êtres qui sont attachés aux activités jugées non viables : utilisateurs de voiture thermique ou de smartphone, agriculteurs à qui on a fait investir dans un matériel démesuré ne pouvant servir que dans une agriculture dopée aux intrants chimiques, écosystèmes vivant de l’exploitation d’une station de ski alpin dont l’enneigement s’effondre…
Fermer des activités, renoncer à des organisations zombies, lancer un oukase sur la non-viabilité d’une production peut être douloureux aussi.
« L’enquête donne un poids à la qualification au titre de commun négatif.”
Démanteler avec soin
Alexandre Monnin plaide pour faire intervenir à ce stade la recherche et sa capacité à enquêter. « L’enquête donne un poids à la qualification au titre de commun négatif qui dépasse les seules dimensions du collectif qui s’en prévaut. » Ceci afin d’éclairer le choix de ce qui vaut la peine d’être maintenu ou ce à quoi il faut renoncer, et dans ce cas, de « démanteler pièce par pièce, mais aussi avec le plus grand soin ».
Démanteler correctement ne consiste pas en un simple retour en arrière mais nécessitera de « produire les savoirs et les arts de la fermeture faisant actuellement défaut ». Cela veut dire aussi, selon lui, accompagner ceux qui sont attachés au système condamné – y compris les plus vulnérables qu’il n’est pas question de laisser sur le bord du chemin – et les aider à trouver d’autres attachements plus viables. En somme, « renoncer aux communs négatifs (…) vise tantôt à anticiper la survenue d’injustices, tantôt à y mettre fin », mais « il s’agit également de prendre en considération les attachements à ces communs négatifs. »
« Il s’agit également de prendre en considération les attachements à ces communs négatifs. »
Il fait alors intervenir la notion de sobriété, proposant une voie de « suffisance intensive » qu’il caractérise par la possibilité de remplacer une croissance infinie en quantité par une croissance infinie en intensité : s’attacher à faire de la musique procure un plaisir infini dans la durée mais sans épuiser les ressources, contrairement aux plaisirs de consommation qui ne peuvent perdurer si les ressources sont limitées.
Au passage, je m’interroge sur ce dernier chapitre assez déroutant : l’exemple de la musique semble un peu léger dans le raisonnement, quand il s’agit de renoncer à des communs négatifs planétaires ou à des pans entiers de notre organisation économique.
Devoir historique
En conclusion, Alexandre Monnin plaide pour trouver un chemin sur une ligne de crête entre le statu quo mortifère du business as usual et les tentations de fermeture brutale et immédiate de la technosphère (si tant est que cette approche radicale façon “khmers verts” existe réellement ?). Pour que cela fonctionne et puisse être accepté collectivement, il faut que cette transformation soit prise en charge et organisée politiquement.
« Ne pas demander à d’autres d’être nos poissons-pilotes.”
C’est une mission que l’auteur assigne finalement à ce qu’il appelle les « nations du Nord ». Elles en ont, dit-il, le devoir historique, pour avoir ouvert la voie de la révolution industrielle, de l’économie extractive et ainsi de suite jusqu’au développement des nouvelles technologies. « Pour ne pas demander à d’autres d’être nos poissons-pilotes, pour ne pas attendre mais susciter les bascules, à la fois politiques et techniques, pour qu’un premier exemple, coupé de l’attente d’un retour sur investissement ou d’un avantage concurrentiel, ouvre la brèche nécessaire. »
Alexandre Monnin anticipe et rejette l’objection que ce vœu soit utopique. On aimerait le croire.
On peut au moins lire cet essai comme une boussole supplémentaire, jamais inutile pour tenter de ne pas gâcher les chances de passer le cap de l’ère délicate qui se profile. Une boussole qui n’est quand même pas toujours facile à lire : c’est un essai dense, emprunt d’un style et d’un vocabulaire de philosophe, parsemé de nombreuses références dont il vaut mieux avoir lu au moins les auteurs les plus connus. Heureusement aéré, ici et là, par des « interludes » qui parleront aux jeunes, et par des exemples concrets qui nous amènent dans les polders des Pays-Bas ou du Bangladesh, dans les stations de ski de Métabief ou de Chastreix, et même dans les fêtes de fin d’année.
(1) Alexandre Monnin – ainsi qu’Emmanuel Bonnet et Diego Landivar – est enseignant-chercheur à l’ESC Clermont Business School et il dirige le Master of Science créé avec eux “Strategy and design for the Anthropocene”. Ils ont initié ensemble, depuis sept ans, une réflexion sur la notion de redirection écologique et sur ses enjeux.
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par l’association loi 1901 Par Ici la Résilience, dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six moyens de participer à notre projet :
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.
Photo de Une : La centrale nucléaire de Tchernobyl en juin 2013. Crédit : Ingmar Runge – licence Creative Commons (CC BY 3.0)



