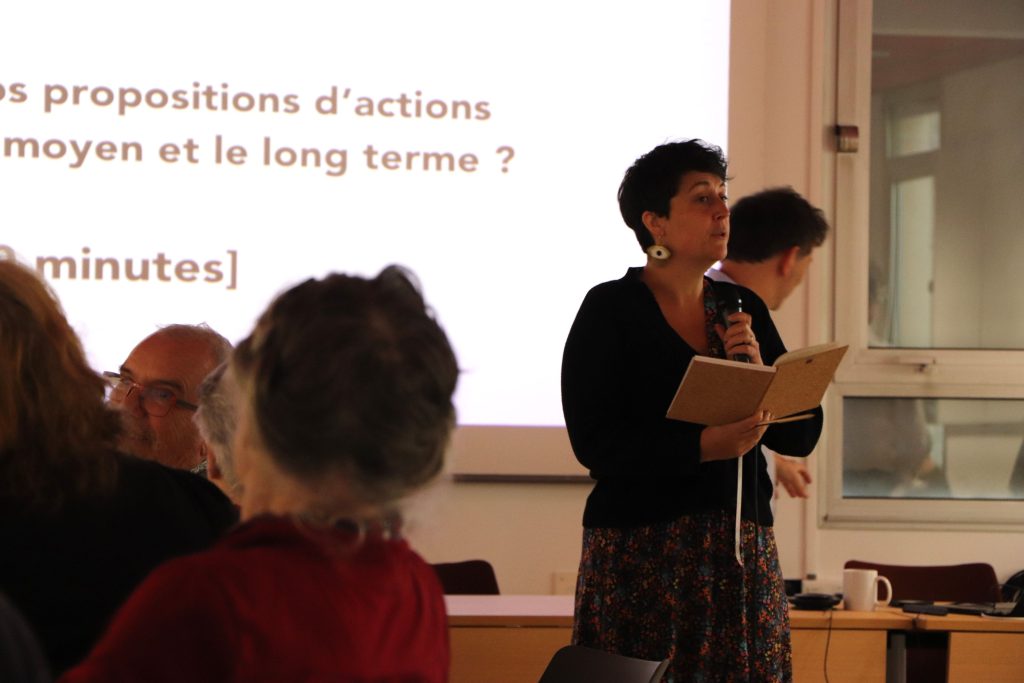Tikographie a besoin de vous
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.
Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.
Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
On commence à bien connaître les conférences d’Arthur Keller qui font le plein un peu partout en France, et dont un certain nombre sont accessibles en ligne (comme, au hasard, celle-ci).
Pour notre part, à Tikographie, le message d’Arthur Keller est une de nos références, et c’est ce que nous essayons de contribuer à mettre en application, en mettant en lumière les initiatives et expérimentations qui vont, pour le dire vite, « dans le bon sens ».
On sait moins qu’après avoir « réveillé » les personnes de son auditoire, il peut aller plus loin en mettant le pied à l’étrier aux collectivités, celles-ci étant selon lui les fers de lance pour engager les mutations nécessaires, pour anticiper les crises et organiser la résilience.
J’ai profité de sa venue à Thiers pour observer comment il s’y prend et pour témoigner de la façon dont il transmet son message sur l’ampleur des crises à venir et sur la façon de s’y préparer.
Libre à chacun – citoyen ou élu – de tirer par la manche les personnes en responsabilité sur son territoire, pour les inciter à suivre l’exemple.
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- Le conférencier Arthur Keller, spécialiste des risques systémiques, était la semaine dernière à Thiers, à l’invitation de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. Après une conférence ouverte à tous les publics, il a animé le lendemain un atelier réservé aux agents de l’intercommunalité et à tous les élus des collectivités du territoire, sur la base du volontariat. Près de 50 participants ont répondu à l’invitation.
- L’atelier commence par un prolongement de la conférence de la veille, pour rappeler quelques préalables : les risques systémiques d’une gravité difficilement concevable et potentiellement irréversibles, la nécessité des territoires d’anticiper ces risques et leurs conséquences, pour s’y préparer, en s’appuyant sur le collectif des habitants et en permettant leur empouvoirement.
- Après cette introduction, l’atelier a consisté en une mise en situation travaillée par groupes. Il s’agissait d’imaginer ce qui se passerait si du jour au lendemain l’approvisionnement en pétrole s’arrêtait, et pour longtemps. Puis de construire un plan d’action de ce qui pourrait être mis en œuvre pour faire en sorte que les choses, localement, se passe mieux que dans le scénario décrit. Pour Thiers Dore et Montagne, l’intention de cet atelier était de commencer à créer une culture commune, à l’heure de relire le projet territorial avec le filtre de l’anticipation des risques systémiques.
Prenez une communauté de communes plutôt rurale et montagneuse. Invitez élus et agents à participer à un atelier sur les risques systémiques. Ajoutez la condition quasi obligatoire d’avoir assisté la veille à une conférence sur le sujet. Vous imaginez qu’ils seront une poignée ? Pas si l’intercommunalité est celle de Thiers Dore et Montagne. Et si l’intervenant est Arthur Keller. Ils étaient une cinquantaine à répondre à la proposition. Avec une part non négligeable de maires et d’élus, mais aussi des agents travaillant dans des services aussi divers que les finances, la culture, l’urbanisme, la santé, le social…

Arthur Keller est le spécialiste en France qui alerte sur le sujet des risques systémiques. Ses conférences sont réputées pour provoquer un sursaut dans l’assistance, car il y démontre de façon très convaincante que des points de bascule sociétaux se profilent, et pourraient se produire avant 2050 : approvisionnement en pétrole bon marché non garanti, capacité de production agro-alimentaire menacée, modèle économique mondialisé moribond, etc. Les sociétés modernes sont plus vulnérables qu’on ne le pense, explique-t-il, car elles dépendent d’un contexte international qui échappe à notre contrôle, d‘un système économique qui atteint ses limites, de conditions climatiques et environnementales qui se détériorent rapidement, de ressources épuisables, et de décisions politiques et géostratégiques étrangères.
Le risque de rupture systémique est selon lui objectivement plausible, sur la base de la littérature académique spécialisée. « On va se retrouver face à des crises d’une magnitude mais surtout d’une nature totalement inédites », lance-t-il en début d’atelier. Il postule donc qu’il faut s’y préparer car, dit-il aussi, « c’est par temps calme qu’on s’organise, pas quand le chaos déferle : à ce moment-là on ne cherchera pas à innover, il faudra que des réponses éprouvées aient été validées et déployées préalablement. »
Mise en condition
Comme ses propos, les ateliers animés par Arthur Keller vont droit au but. Pas d’ice breaker ou de post-it, pas de facilitation graphique ou de consignes compliquées, de jeu de rôle ou de dispositif ludique. On forme trois cercles. Chaque cercle échange et répond successivement à trois questions, dans ce qu’il annonce comme une « mise en situation ».
« On va se retrouver face à des crises d’une magnitude mais surtout d’une nature totalement inédites. »
Une mise en situation, cela consiste à plonger les élus dans des circonstances fictives de crise grave mais réaliste, et à les inviter à réfléchir ensemble pour imaginer ce qui se produirait, ce qu’ils pourraient faire ou subir, en visualisant les implications pour le territoire… puis à leur demander de produire des propositions d’actions. Pour que l’atelier soit productif, il ne lui faut rien de plus qu’une mise en condition. Autrement dit, un prolongement de sa conférence en introduction de l’atelier. Arthur Keller, avec son débit précipité qui fait monter le sentiment d’urgence, énumère les constats, les écueils et la nécessité de se préparer. Essayons d’en résumer les éléments clefs.

Les constats ? « Les risques les plus disruptifs, dont la survenue est à mes yeux certaine, ne sont pas encore conscientisés, y compris par les instances chargées d’anticiper les risques ; leur approche par risques d’événements ponctuels n’est pas adaptée aux processus systémiques. » Les réglementations à l’échelle nationale ou territoriale comportent de nombreux angles morts, dit-il. Il l’illustre par les plans de prévention des risques et plans communaux de sauvegarde, qui se cantonnent à inventorier les risques identifiés localement, ou bien par le Dicrim, document d’information qui n’est généralement pas connu des populations.
Exemple glaçant : le risque de rupture alimentaire générale, pourtant plausible à l’heure d’une l’agriculture mondialisée tributaire d’approvisionnements, de systèmes et réglementations sur lesquels le pays n’a généralement pas la main, « ne fait même pas partie des aléas identifiés, car on part du principe que l’insécurité alimentaire appartient au passé : c’est un impensé systématique. »
| Pour se faire une idée des conférences que donne Arthur Keller à travers la France, lire aussi le reportage : « A la conférence d’Arthur Keller, des coups de massue, des leviers locaux et une lueur d’espoir » |
La peur comme levier
La conclusion s’impose : « Le réveil et la transformation doivent venir du bas, dans des territoires qui se retroussent les manches, le font savoir et se relient », pour que progressivement le changement radical d’approche infuse dans d’autres territoires, puis remonte dans les sphères décisionnelles. D’où la présence du conférencier pour faire plancher les collectivités locales : le salut viendra d’abord d’elles… à condition qu’elles évitent les écueils, apprennent à se coordonner efficacement et opèrent des pas de côté inhabituels en matière de posture.
« Vous devez devenir les agents d’une mutation de nature avant tout culturelle. » Arthur Keller les met en garde particulièrement dans le domaine de la communication, une erreur courante consistant à minimiser les risques pour ne pas affoler. Son conseil : développer une culture du risque, de la responsabilité et de la solidarité, sans négliger la puissance des émotions pour déclencher la mise en action. Ne pas avoir peur de la peur, car il s’agit de créer un indispensable électrochoc… À condition toutefois de ne pas laisser les gens seuls avec leurs peurs. « Il est urgent de proposer aux gens des cadres et contextes spécifiques où venir exprimer leurs émotions de façon constructive et créative, prévient-il. Sinon ils rejoignent les extrêmes, où la colère, la frustration et l’indignation prennent souvent des formes nocives. »
« Il faut faire passer le message que c’est collectivement qu’on s’organise. »
Ne pas minimiser les risques et créer des dissonances cognitives, apporter du désir en complément de la peur, donner aux gens « des opportunités concrètes d’engager des changements profonds », avertir qu’il faudra « non pas faire autrement mais faire autre chose, repartir d’une page blanche
face aux périls nouveaux de notre temps », et éviter l’entre-soi : tout ça fait partie des clefs qu’il apporte pour une indispensable mise en récit. Car « il faut que ça se sache », « il faut faire passer le message que c’est collectivement qu’on s’organise. »

Imaginez que…

Mais alors, comment on s’organise ? C’est là qu’interviennent la mise en situation et les trois questions. Une mise en situation suppose un début d’histoire proposée aux participants, commençant par « Imaginez que… ».
En l’occurrence, ils devaient imaginer que le lundi suivant l’atelier, alors qu’ils se préparent en vue de partir travailler, un proche les appelle et leur enjoint d’allumer la télé sur le programme BFMTV. À ce stade, les participants manifestent un mélange d’amusement et d’indignation de bon augure : le public n’est manifestement pas client de la chaîne, donc déjà capable de prendre le recul nécessaire pour accepter que la suite est plausible. À l’antenne, un expert dont ils n’ont jamais entendu parler explique à grands renforts de formules dramatiques que les principaux fournisseurs de pétrole de l’Europe ont décidé, pour une quelconque raison géopolitique, de couper les approvisionnements sur-le-champ. L’individu explique que le continent risque de manquer de tout très vite, et que rien à ce stade ne permet de savoir pour combien de temps, avec des conséquences potentiellement dévastatrices.

Les trois groupes ont alors à imaginer la suite en répondant d’abord à la question : « Que se passe-t-il autour de vous dans la première journée ? », puis « Comment réagissez-vous ? ». Puis l‘histoire reprend et Arthur Keller propose une ellipse : après quelques semaines de chaos et de négociations, les approvisionnements reprennent, et la troisième question survient à ce stade : « Quelles mesures préconisez-vous à court, moyen et long terme, pour que les collectivités aient la capacité d’affronter plus sereinement une nouvelle alerte de même ordre, qui pourrait, la prochaine fois, s’inscrire dans la durée ? »
| Pour découvrir le récit d’un autre type d’atelier, lire aussi le reportage : « Atelier adaptation : un premier pas pour agir localement » |
Scènes de chaos
Les deux premières questions ont donné lieu, pendant les échanges et au moment de leur restitution, à des visions plutôt chaotiques : scènes de panique, paralysies, ruée vers les stations services et les supermarchés, vérification des listes de personnes vulnérables, tentatives de coordination avec les collectivités voisines, réunions de crise approximatives, questionnements sur les stocks disponibles et les besoins, de l’entraide et de l’improvisation, des lacunes dans les protocoles et dans les compétences…

Arthur Keller apporte à chaque temps de restitution quelques précisions et remarques utiles. « Certes on ne peut pas prévoir tous les cas de figure, mais il vaut mieux ne pas attendre le moment de la crise pour organiser ce qui peut l’être », insiste-t-il. Il recommande d’identifier au préalable les fonctions et les compétences qui pourront servir. Il cite en exemple l’hôpital Bichat, dont le directeur des urgences a eu l’idée de former tout le service à la médecine de guerre : ce qui est apparu saugrenu à certains sur le moment, mais s’est avéré précieux lors de l’attentat du Bataclan. « Le jour où survient la crise, on est content d’avoir anticipé. »
« Les meilleurs gestionnaires des crises hors cadre sont des profils très particuliers. »
Il souligne aussi que le stockage de nourriture à l’échelle individuelle ne suffit pas car il peut être source de conflits, et qu’il est important d’organiser des stocks communaux ou intercommunaux cogérés avec les habitants. Il est utile aussi de prévoir le cas où les réseaux de communication s’arrêtent de fonctionner, le cas où il n’y aurait plus de pétrole ou plus d’électricité.

Ces quelques clignotants allumés, ajoutés aux échanges des deux premières questions, permettent à la dernière phase de produire sa pleine efficacité. L’animateur l’amène en faisant allusion à une autre catastrophe, celle de l’ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005. Cet épisode enseigne que « les meilleurs gestionnaires des crises hors cadre sont des profils très particuliers, capables d’improviser sous la pression, de casser les conventions, de tester des choses, d’innover. » Il fera allusion à un autre moment à « la posture de MacGyver », inspirée du personnage d’une série des années 1980 ayant l’art de régler toutes les situations « en utilisant les ressources dont il dispose et en les détournant de leur usage premier pour trouver une solution créative et concrète à un problème. » Enfin il rappelle l’importance de l’entraide en période de crise – « mais c’est mieux de l’avoir encouragée en amont ».
Renoncement et petit gueuleton
Ce cheminement de toute une matinée a permis d’aboutir à des plans d’action déjà précis et co-élaborés, presque prêts à mettre en place à l’échelle des communes, avec des actions classées selon leur échéance.
À court terme : la mise à jour des recensements, des stocks, des numéros et alertes, l’achat d’un mégaphone ou de vélos. À moyen terme : la révision (voire la création selon les cas) du plan communal de sauvegarde et du plan de continuité des activités en intégrant les risques systémiques, mais aussi les exercices grandeur nature, les formations et les dispositifs d’information en cas de panne des réseaux, la répartition des rôles, le repérage des compétences, etc. À long terme : l’adaptation en profondeur pour disposer d’approvisionnements locaux dans la durée et de moyens de fonctionner en conditions dégradées, la mise en récits et, comme dit l’une des rapporteurs, « s’orienter vers un changement de société » ou dit autrement par un autre, « arrêter très vite le business as usual. »
« Simple, rapide, efficace », commente Arthur Keller. Lequel a encore des recommandations à ajouter dans sa longue clôture de l’atelier. Il invite les participants à s’approprier la méthode et à l’appliquer à diverses situations : « Vous faites une liste de risques graves et plausibles, puis de temps en temps, vous prévoyez un brainstorming pour réfléchir sur une de ces hypothèses, envisager ces crises et coproduire des idées pertinentes. Cette préparation salutaire de vos territoires, ça commence par vous », leur rappelle-t-il.
« Le monde n’a pas besoin de 1001 nouvelles expériences. »
D’autres informations pratiques suivent : prévoir des sauvegardes des documents indispensables, sécuriser les sauvegardes papier, cartographier les compétences « qui ne sont peut-être pas celles qu’on imagine », faire connaître ce qui a été mis en place car « le monde n’a pas besoin de 1001 nouvelles expériences mais d’une grande alternative sociétale constituée de 1001 alternatives reliées entre elles », créer « les conditions du passage collectif à l’action », en faisant en sorte que les citoyens apprennent à se connaître, par exemple en organisant de temps en temps « un bon petit gueuleton »…

Il termine par un chapitre d’apparence plus complexe, tout en expliquant qu’il est réalisable : « Nous avons impérativement besoin de renoncer à certaines de nos pratiques et nous devons nous poser la question, collectivement et sans trop attendre : à quoi est-on prêt à renoncer ? » C’est envisageable, promet-il, à condition de faire comprendre que renoncement n’est pas forcément synonyme de privation. « Moins l’on consentira à renoncer au superflu, plus le risque sera grand que d’ici à quelques années nous soyons nombreux à nous retrouver privés de l’essentiel. »
État d’esprit
En conclusion de sa clôture, il relève « l’excellent état d’esprit » des participants et les encourage : « On y va, tous sur le pont ! On tente. Au pire ça ne marche pas, mais vous pourrez regarder vos enfants en face parce qu’au moins vous aurez vraiment essayé. Malgré les défis difficiles qui nous attendent, nous avons une chance : celle de pouvoir devenir les héros de ceux que nous aimons. »
Le plus étonnant (ou réjouissant), ce sont les ressentis des participants à la sortie de l’atelier. Pas de sidération, de réticence ou de découragement comme on s’attend à en rencontrer auprès des publics confrontés pour la première fois aux réalités exposées par le conférencier. Mais des agents et des élus déjà conscients de ces risques – il est vrai qu’ils étaient volontaires pour participer – et même, pour certains, engagés pour les prendre en compte.
« La commune est loin de tout. »
Telle la maire d’une petite commune rurale qui m’explique avoir déjà mis en place quasiment tout ce qui a été suggéré, de l’achat du mégaphone à la rédaction d’un plan de sauvegarde musclé, de la répartition entre les élus des administrés à contacter jusqu’au développement de productions agricoles vivrières. Elle m’explique que « la commune est loin de tout, les communications ne passent pas bien, les transports sont compliqués, alors il faut bien s’organiser. On est assez soudés et la convivialité pour créer de la solidarité, on connaît ! »
Créer une culture commune
De son côté, une responsable financière me confie qu’elle a vécu la période du covid à l’Agence régionale de Santé, ce qui donne, dit-elle, une bonne idée des effets potentiels de l’impréparation dans une situation de crise. « Il faut qu’on se bouge », dit-elle.
Une employée à la culture, consciente du rôle de son domaine dans l’équation, relève les propos du conférencier sur l’importance du récit et des imaginaires, sur le recueil de l’expression des habitants. Sa collègue de l’urbanisme se réjouit de voir des élus présents « car à notre échelle, on ne peut pas faire grand chose s’ils ne sont pas avec nous ». D’autres encore partagent leur enthousiasme ou leur impression que « c’est du bon sens ».
Ça tombe bien, car le but de la matinée était de mettre la communauté de communes en mouvement, à l’heure où elle entame la révision de son projet de territoire. Plus exactement, le but était double, explique Rachel Bournier, vice-présidente en charge de la transition écologique et du développement durable : « Je constatais que les commissions au format classique, très descendantes, étaient de plus en plus boudées par les élus et il m’a semblé important d’essayer autre chose pour raviver l’attention sur un sujet aussi prégnant et transversal ; d’autre part, il s’agissait dans une première étape de créer une culture commune, de susciter un éveil et une vision pour l’avenir du territoire, car chaque élu est en responsabilité et se doit d’anticiper les risques. »
« C’est le démarrage de quelque chose d’ambitieux. »
Saluant le volontarisme du président de Thiers Dore et Montagne, Tony Bernard, « ouvert et à l’écoute sur ces sujets » et de quelques élus qui les portent avec elle, la maire de Sauviat regrette tout de même d’avoir mobilisé trop peu de ses collègues, sur les 420 membres des conseils municipaux invités à l’atelier. Mais elle se réjouit de la belle mobilisation des agents de la communauté de communes et reste confiante pour la suite : « C’est le démarrage de quelque chose d’ambitieux », dit-elle.

Ce « quelque chose » va consister, explique-t-elle, en une relecture du projet de territoire « avec le filtre du risque systémique », non pas pour tout changer dans un projet qui vient à peine d’être validé, mais pour prendre davantage en compte ces risques dans les arbitrages et orientations d’actions, peut-être ajouter ou renforcer certains points.
La conclusion provisoire qui vient à Rachel Bournier : « Ce format sera amené à être renouvelé. » Peut-être pas à chaque fois avec un animateur aussi prestigieux, mais au moins, ce lancement aura impulsé un bel élan pour commencer à faire autrement. Ou plutôt, si vous avez bien suivi, pour « faire autre chose ».
Reportage (texte et photos) Marie-Pierre Demarty, réalisé le vendredi 10 octobre 2025. À la une : Après son introduction en format conférence, Arthur Keller invite les participants à former trois groupes pour réfléchir sur une mise en situation.
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.