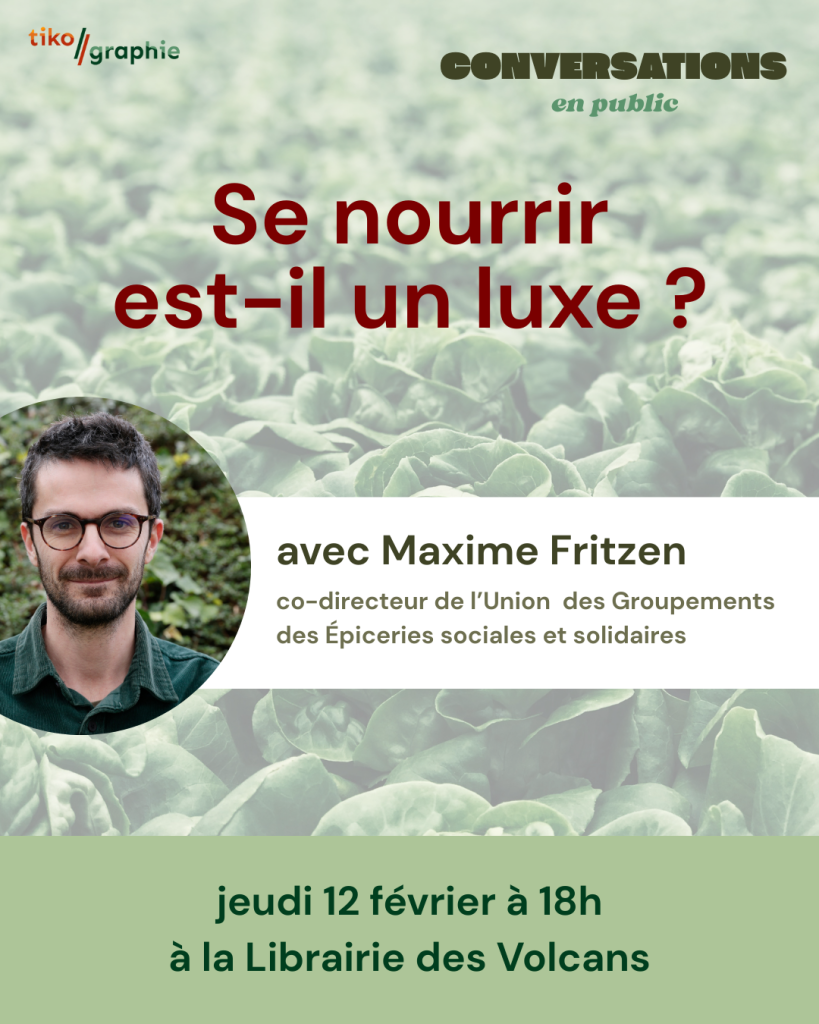Tikographie a besoin de vous
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.
Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.
Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
Quand la nature brûle, on se sent un peu tous en deuil. En tout cas moi…
Quand c’est une réserve de biodiversité qui brûle, ça ajoute de l’inquiétude à la tristesse. Il y a là comme une contradiction injuste : ce qu’on s’efforce de préserver à longueur d’années peut être ravagé en quelques heures.
Il y a aussi un côté symbolique dans un tel événement : n’est-ce pas une belle métaphore de ce que nous vivons à l’échelle de la planète ?
Mais comme je ne suis pas du genre à rester sur des interrogations pessimistes, il m’a semblé pertinent d’essayer de comprendre quelques mécanismes de résilience – de la nature et des humains – à partir de cet épisode.
C’est pourquoi, plutôt que d’aller interroger les secours mobilisés sur le moment (pour ça, vous n’avez pas besoin de Tikographie ; même les médias nationaux s’en sont faits l’écho), j’ai voulu comprendre où en est le site quelques mois plus tard, quand la végétation a commencé à retrouver sa place.
Est-ce bien toujours la même place ? Est-ce que des choses se sont transformées ? décalées ? ont définitivement disparues ? ont modifié des habitudes ? Quelles questions demeurent ? Quelles risques ? Quelles traces…?
J’y suis même retournée deux fois. Fin mai, pour constater (et photographier) l’étendue de cette immense traînée brune sur la montagne, puis fin août pour en discuter avec le conservateur de la réserve.
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- L’incendie du 7 avril dernier s’est propagé sur près de 200 ha, sur les pentes du Mont Redon, presque entièrement dans le périmètre de la réserve de Chastreix-Sancy. Il n’a heureusement embrasé ni l’étage forestier, resté humide au sortir de l’hiver, ni les crêtes ou le cirque de la Fontaine salée, milieux les plus riches et rares en biodiversité. Le feu a brûlé surtout, assez superficiellement, sur des pelouses de pâturage, et plus intensément dans des landes à genêt.
- Le conservateur de la réserve avec son équipe s’est improvisé guide et conseiller pour les secours, en s’efforçant de les conduire justement à préserver ces zones les plus précieuses. Il a délivré un message confiant aux médias, tout en s’étonnant de leur intérêt pour la réserve plus que pour les éleveurs impactés. Sa prédiction de voir la végétation presque effacer les traces de l’incendie dès l’été s’est avérée juste. Mais à observer la zone de plus près, on devine que tout n’est pas simplement « rentré dans l’ordre ».
- Les écosystèmes pourraient mettre une dizaine d’années à retrouver leur fonctionnement précédent. Car les insectes et invertébrés ont été affectés, la nature des sols a changé. Concernant la prévention incendie dans des zones protégées, des questions se posent et restent en suspens : faut-il faire des compromis sur l’ouverture des chemins ou la pression des pâturages afin de réduire le risque ? Ou tolérer un risque encore minime, mais qui pourrait croître avec le dérèglement du climat ?…
« Nous avions identifié le feu comme menace potentielle, mais pas vraiment en hiver, bien qu’il y ait eu un précédent en 2016 dans la vallée de Chaudefour », reconnaît Thierry Leroy, conservateur de la réserve de Chastreix-Sancy.
Pourtant le feu a pris au sortir de la période hivernale, le 7 avril dernier, sur les pentes du Mont Redon. À cette époque de l’année, on est encore « normalement » en période froide vers 1500 m d’altitude. Mais qu’est-ce qui est normal aujourd’hui en termes de météo ? Le temps était estival et on a enregistré à cette période des maximales à 17°C à Chastreix et 26°C à Clermont (soit 10°C au dessus de la normale climatologique). « Il y avait eu peu de neige dans l’hiver, il n’avait pas plu depuis plusieurs semaines et la montagne était très sèche. Le vent était fort. Le feu est parti très vite », poursuit le conservateur.
Guider les secours
Un feu accidentel, déclenché par quelques étincelles alors qu’une personne travaillait sur la zone. Rappelons les faits : l’incendie déclaré en milieu de journée du 7 s’est propagé sur près de 200 ha, presque entièrement dans le périmètre de la réserve, sur les pentes du mont Redon et jusqu’au roc de Courlande. Pour situer la zone : elle se trouve juste de l’autre côté des crêtes au sud de la station de ski de Chastreix. Le feu a mobilisé 200 pompiers, une cinquantaine d’engins d’intervention, un hélicoptère et un avion bombardier. Il a été maîtrisé le lendemain matin, sans faire de victime humaine.

« Les secours étaient très bien organisés mais pas comme ils le sont dans le sud. On n’a pas ici la culture des grands incendies. Et particulièrement ici, l’intervention a été compliquée par la difficulté d’accès avec très peu de pistes dans le secteur, et la méconnaissance du terrain », a constaté Thierry Leroy, qui s’est très vite mis avec son équipe à disposition des secours, sans chercher à s’imposer. Mais ils ont rapidement été intégrés au dispositif d’intervention, pour apporter leur expérience et leur connaissance du terrain.
« Il était important de défendre les zones à fort enjeu de biodiversité. »
« Nous avons été utiles à deux niveaux : d’une part pour repérer les accès possibles, d’autre part pour déterminer la stratégie de défense du feu. Pour les objectifs de conservation de la réserve, il était important de défendre les zones à fort enjeu de biodiversité : le cirque de la Fontaine salée et les crêtes. La zone qui a brûlé ne contenait pas de milieux rares : ce sont des landes basses à myrtilles, des pelouses et des landes à genêt purgatif », explique-t-il.
| A lire aussi ou à écouter en podcast, notre rencontre : « Feux de forêt : quels risques pour le Puy-de-Dôme ? » |
La réserve sous les projecteurs
Les jours suivants ont été consacrés à deux tâches principales : fermer les rares chemins traversant la zone, puis les rouvrir dès le 9 une fois le risque passé ; et répondre à la presse. « J’ai été surpris que les médias s’intéressent surtout à la réserve, alors que les éleveurs ont été impactés et le village de Chastreix a été éprouvé. Cela m’a fait percevoir la notoriété de la réserve », relève Thierry Leroy, qui a pris tout de suite le parti de délivrer un message d’apaisement. « C’est une crise, mais pas une catastrophe », a-t-il communiqué dès ces premiers jours, faisant le pari que la végétation serait largement de retour et que les traces du feu seraient à peine visibles dès juillet.
Pari à peu près tenu, sauf dans les zones de genêts dont les tiges ligneuses faisaient encore cet été dépasser de la verdure leurs étranges griffes calcinées. Et aujourd’hui encore, tout en reconnaissant que l’équipe a été bien secouée, il se réjouit que le sinistre soit survenu « à la moins mauvaise des périodes, alors que la faune et la flore étaient encore endormies ». L’impact sur la faune, dit-il, a surtout touché ceux qui n’ont pas pu fuir devant le feu : invertébrés, insectes, larves, araignées, petits reptiles.
« J’ai été surpris que les médias s’intéressent surtout à la réserve, alors que les éleveurs ont été impactés. »
L’incendie a d’abord compliqué les choses pour les trois éleveurs qui font pâturer leurs troupeaux sur cette zone. Une perte d’herbe, des clôtures à refaire, pour des coûts que les assurances peuvent cependant couvrir. Il a aussi été recommandé de faire monter les vaches sur cette estive plus tard qu’habituellement, pour ne pas risquer de trouver des aliments toxiques au menu du déjeuner.
La végétation de retour
Et la végétation ? « Elle n’a pas brûlé de façon homogène. Il y avait un vent tournant qui a fait faire des sauts au feu, en épargnant certaines zones. Les pelouses ont été brûlées très superficiellement. Par contre, il a pris de l’intensité dans les landes à genêts dont les parties ligneuses sont particulièrement inflammables. Dans ces secteurs, les flammes montaient à 20 mètres de haut. Par contre la forêt n’a heureusement pas brûlé, car le sous-bois était humide et les arbres n’étaient pas secs. Les prairies de fauche ont été épargnées aussi. C’est une chance », résume le conservateur.
« La composition végétale va changer de toute façon, car l’incendie a modifié les sols et a fait disparaître les invertébrés. »
Il se félicite des atouts de la réserve, dont « les milieux très naturels, de très bonne qualité, ont permis une reprise rapide de la végétation, aidés par les zones que le feu n’a fait qu’enjamber. » Dans les pelouses notamment, « le verdissement a été net et rapide, dès le mois de mai, et la zone des landes basses est maintenant redevenue verte quasiment à 100 % », notait-il fin août, lors de notre rencontre.
Le retour de la végétation est plus lent dans la zone des genêts, explique-t-il, parce que cette plante émet des toxines qui bloquent la germination des autres végétaux afin d’occuper le terrain. Des herbacées commencent cependant à se frayer un espace, et surtout, ce sont les espèces pionnières, spécialistes de la reconquête des friches, qui se réinstallent : ronces, framboisiers et épilobes notamment. « La composition végétale va changer de toute façon, car l’incendie a modifié les sols et a fait disparaître les invertébrés. Il faudra sans doute une dizaine d’années pour que ça ressemble à ce que c’était avant », note le conservateur.

Observer la renaissance
Pour mieux connaître et comprendre cette régénération, l’équipe de la réserve a mis en place un suivi régulier et global, documenté par les observations, notes, photos et relevés des espèces observées.
Le suivi pourra aussi s’appuyer sur les photos satellitaires existantes qui permettront de mesurer le verdissement. Mais il restera des éléments manquants sur les populations qui n’ont pas été inventoriées avant l’incendie, notamment parmi la petite faune, les insectes, certains oiseaux. Comment savoir ce que l’incendie a fait disparaître si on ne savait pas qui était présent ?

De façon plus standardisée, un suivi botanique précis a été mis en place sur deux milieux différents : les pelouses et les landes à genêts. Cela consiste à installer environ 80 « placettes », petits périmètres repérés par un piquet, où la végétation sera inventoriée sur plusieurs années. « Cela va nous permettre de comparer avec ce qui était présent avant, de mesurer comment les espèces reviennent, de tirer des enseignements et de conforter le message », dit Thierry Leroy.
Si jamais il devait y avoir une prochaine fois, celui-ci reconnaît que les réactions et recommandations ne seront pas différentes, « mais nous réagirons plus facilement car nous aurons eu cette expérience », note-t-il. Et les gardiens de la réserve seront encore plus facilement écoutés qu’ils sont désormais bien identifiés par les responsables du secours. Pour preuve : ils ont été invités à un regroupement d’entraînement au Mont-Dore.

Des questions non tranchées
Thierry Leroy est tout de même sensible à deux remarques qui lui sont remontées après coup et méritent réflexion, voire une étude plus poussée, avant de décider ce qui est le plus adapté pour la prévention des incendies dans le contexte particulier d’une réserve naturelle.
Le premier concerne les prairies. L’orientation de la réserve naturelle est de diminuer le plus possible le pâturage pour favoriser la naturalité des milieux présents. Mais certaines personnes ont fait observer que cette faible pression du pâturage avait favorisé la présence d’herbe sèche, plus inflammable. « Cela reste à discuter, souligne le conservateur. Car le développement du pâturage n’est pas très bon pour la nature et va à l’encontre des orientations de la réserve. Ne vaut-il pas mieux accueillir un feu de temps en temps ? »

Dans le même ordre d’idées, il a été suggéré de créer des pistes d’accès pour pouvoir circuler avec des engins de lutte contre l’incendie. « Nous n’y sommes pas opposés dogmatiquement, mais cela impliquerait une hausse de la fréquentation et une fragmentation des milieux, ce qui peut nuire aussi à la préservation de la biodiversité. Je serais plutôt favorable à étudier les points faibles des chemins existants et à les maintenir en bon état. Par exemple, pendant l’incendie, un camion-citerne s’est embourbé dans la plantation d’épicéas et il a fallu un tracteur pour le sortir. Ça devrait pouvoir être évité. »
Spécificités d’une réserve
Un dernier point chiffonne le conservateur : certaines zones ont été arrosées avec un produit retardant dont les pompiers lui ont assuré qu’il était inoffensif. Il n’empêche que sa couleur rouge et l’impossibilité d’en apprendre plus sur sa composition ne sont pas faites pour le rassurer. Il sera peut-être utile de creuser la question de l’impact de tels produits sur des milieux fragiles.
Force est de reconnaître qu’un incendie dans une zone naturelle et protégée, sans risque (en l’occurrence) sur des habitations ou des installations humaines, a ses spécificités et n’est en rien comparable, en termes d’ampleur et d’enjeux, aux récents méga-feux de l’Aude ou de Gironde.
La structure qui chapeaute l’ensemble des réserves naturelles de France a mené une réflexion approfondie sur le sujet et propose des formations, des cahiers techniques, des préconisations. Mais l’arrivée de la saison estivale très fréquentée n’a pas laissé le temps à Thierry Leroy de s’approprier ces outils. Il se promet cependant de le faire. Car la résilience d’un territoire, même naturel, passe par l’anticipation et la connaissance de toutes les options. Et les prévisions d’évolution du climat laissent augurer que ces leçons de l’incendie ne seront peut-être pas inutiles.
| Pour en savoir plus sur la réserve de Chastreix, lire le premier volet : « Chastreix-Sancy #1 : une approche novatrice de protection de la biodiversité » et consulter la page dédiée sur le site du parc des Volcans d’Auvergne. |
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé le jeudi 28 août (entretien) et le vendredi 30 mai 2025 (reportage photo). À la une : les genêts calcinés et la pelouse qui commence à reverdir, en mai, sous le roc de Courlande.
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.