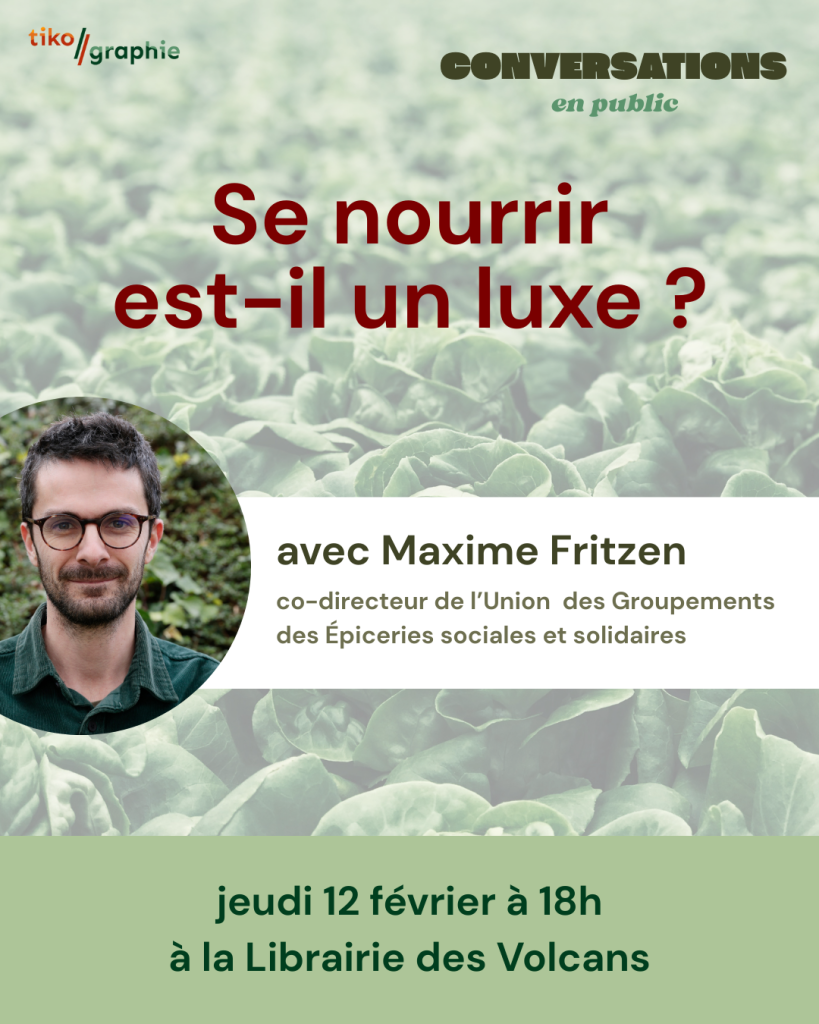Tikographie a besoin de vous
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.
Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.
Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
Si vous avez lu mon dernier article avant celui-ci (je vous le conseille !), vous savez que la grande gentiane de nos montagnes ne s’épanouit que là où pâturent les vaches. Voici un autre exemple d’association heureuse entre plantes sauvages, animaux d’élevage et activité humaine.
A travers ces deux exemples, on voit que la question « pour ou contre l’élevage » est un peu plus complexe que la robe noir et blanc d’une prim’holstein. Mais il y a bien d’autres enseignements à recueillir de l’observation des coteaux secs et de la façon dont ils sont dorlotés dans les programmes de préservation de la biodiversité.
Car ces espaces qu’on a négligés depuis des décennies, véritables emblèmes de la déprise agricole, reviennent au centre de toutes les attentions avec des enjeux de résilience territoriale qui sont principalement de deux ordres : l’autonomie alimentaire et le dérèglement climatique.
J’ai déjà à plusieurs occasions abordé le premier, notamment à travers des sujets sur la vigne ou sur l’arboriculture. Aujourd’hui, voici un éclairage principalement sur le deuxième point.
Et c’est tout aussi passionnant.
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- Particulièrement abondants dans la Limagne des buttes, les coteaux secs sont des milieux naturels comparables aux habitats méditerranéens. Cette configuration peut être due à différents facteurs plus ou moins combinés : un microclimat, une exposition au sud, la pente qui réduit l’épaisseur des sols. On y trouve une faune et surtout une flore spécifiques, composant différents milieux : forêts, broussailles, et surtout des pelouses très ouvertes accueillant de nombreuses espèces d’orchidées.
- Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne gère une trentaine de sites protégés sur des coteaux secs, dont le puy de Pileyre, entre Vertaizon et Chauriat. Celui-ci est protégé en tant qu’Espace naturel sensible et site Natura 2000. Cette butte de pépérite, roche mélangeant basalte volcanique et roche sédimentaire, se compose de différents types d’habitats, dont une pelouse à orchidées remarquable, accueillant 17 espèces. Elle est aussi un jalon du corridor de circulation de l’azuré du serpolet, un papillon classé espèce menacée. Et pour maintenir la diversité de ces milieux naturels, le CEN a invité un troupeau de moutons à pâturer une partie du site, soutenant ainsi l’installation d’éleveurs.
- Le principal enjeu de ces sites de coteaux secs est lié au dérèglement climatique. Car les espèces méditerranéennes qui ont un cycle de vie suffisamment rapide ont tendance à remonter vers le nord pour trouver des conditions de vie qui leur sont plus favorables. Les pelouses sèches réunissant déjà ces conditions, elles peuvent accueillir la faune et la flore pionnière, pourvu qu’on les maintienne en bon état écologique.
C’en était presque drôle : vous allez faire un reportage sur les coteaux secs et… il pleut à seaux ! La lande est détrempée, vous pataugez dans la glaise, vos notes sont en train de se piqueter de gouttes d’eau même sous le semblant d’abri d’un grand chêne touffu.
Mais cela va de soi : même si la Limagne est en moyenne nettement moins arrosée, par exemple, que l’ouest du département, « sec » est ici une notion toute relative, surtout en ce printemps pluvieux. Ce qui singularise d’abord ces milieux particuliers, c’est la végétation qu’ils accueillent : peu d’arbres dans la pente, plutôt des arbustes, des ronces et des herbes, des espèces qui aiment la chaleur. Ce que traduit leur nom savant de « milieux thermophiles ».
Pentes et microclimats
Pour comprendre de quoi il s’agit, je suis donc montée jusqu’au sommet du puy de Pileyre, une première fois avec Vincent Legé, chargé de projet au CEN (Conservatoire d’espaces naturels) d’Auvergne – puis une deuxième fois cette semaine, pour avoir un aperçu moins humide des lieux. Le terme « sommet » paraît un peu ridicule car il culmine à 518 mètres, soit environ 100 mètres au-dessus de la plaine qui l’entoure, entre Chauriat et Vertaizon, dans ce qu’on appelle communément la « Limagne des buttes ».

Mais c’est tout de même un point haut et depuis le sommet du Pileyre, on en aperçoit d’autres, plus ou moins élevés, de forme pointue, arrondie ou oblongue, rythmant le paysage de la plaine céréalière. À l’ouest, la grande masse du puy de Mur ; au sud-est les Turlurons jumeaux veillant sur Billom ; au nord, la colline de Vertaizon. D’autres plus modestes : puy Benoît, puy Saint-Jean, puy de la Poule. Tous résultent de phénomènes volcaniques surgis après la formation de la Limagne : coulées, dômes, maars… Pour le puy de Pileyre, nous sommes sur un site de pépérites, dont Vincent m’explique l’origine : « La lave a rencontré une nappe d’eau qui a provoqué des explosions, formant des rochers où se mélangent les roches sédimentaires claires et les basaltes noirs, d’où ce nom qui évoque des grains de ‘poivre’. »
Mais il me précise très vite que ni la géologie, ni même l’altitude n’ont d’influence sur la caractérisation des coteaux secs : « On peut en avoir en montagne ou dans la chaîne des Puys, parfois même avec une zone humide au milieu. Ce qui fait le phénomène, ce sont surtout les microclimats, l’exposition, ou la pente qui fait que les sols sont peu épais. Les arbres y sont présents mais poussent moins bien et on va avoir des paysages plus ouverts, des landes, des broussailles, des pelouses. »

Un enjeu majeur
Dans notre département, les coteaux secs incluent aussi les coulées de lave à l’ouest de la Limagne. Châteaugay, Cotes de Clermont, Gergovie, montagne de la Serre… Et côté est, « ça s’arrête autour de Billom », précise Vincent.
« On ne sait pas vraiment ce qu’il y aura ici dans 50 ans, mais il est important de préserver ces espaces. »
Le CEN, et avec lui tous les organismes qui se soucient de la préservation de la biodiversité, portent une attention particulière à ces milieux, notamment pour une raison précise : ils offrent des conditions de vie proches du climat méditerranéen et constituent les meilleures chances d’adaptation de la biodiversité pour l’avenir. « On ne sait pas vraiment ce qu’il y aura ici dans 50 ans, mais il est important de préserver ces espaces pour accueillir des espèces qui vont se déplacer en raison du changement climatique », poursuit Vincent.
Décortiquons l’idée, en nous penchant sur le cas du puy de Pileyre.

| Sur une autre action du CEN Auvergne, lire aussi : « Grâce au verger conservatoire de Tours-sur-Meymont, la tradition fruitière locale reprend des couleurs » |
Habitats multiples
« Notre enjeu principal, c’est de protéger les habitats naturels, en considérant que s’ils fonctionnent correctement, si sur le coteau il y a un peu de broussaille, un peu de forêt, un peu de zones ouvertes de type pelouses, les espèces associées à tous ces milieux vont rester ou pouvoir s’installer », explique mon guide. Et ce faisant, il énumère en me les montrant les différentes « ambiances » présentes sur le site : côté Vertaizon, la zone des rochers de pépérite, escarpée, herbes hautes, des chênes épars dont celui où nous tentons de nous abriter ; plus au sud, sur une sorte de plateau allongé, un bois où les pins se mêlent à toutes sortes de feuillus ; côté ouest il est bordé par une pelouse à orchidées, et à l’étage en dessous, une vigne, des zones embroussaillées. Les pourtours sud et est sont en partie cultivés.

Signalons aussi une zone qui a été concédée aux amateurs de motocross. « Quand nous sommes arrivés dans les années 2000, ils étaient sur tout le site. En accord avec leur association, ils se sont repliés sur un terrain précisément délimité et nous avons des rapports de bon voisinage avec eux. Il reste un peu de fréquentation sauvage sur la zone protégée, mais beaucoup moins. Il faut y faire attention. »
« Les espèces phares, ici, ce sont les orchidées. »
Voilà pour les habitats dont le CEN cible la protection. Mais comme le dit Vincent, « les espèces, c’est plus sexy que les habitats » et quelques-unes sont mises en valeur sur les panneaux de sensibilisation qui accompagnent les promeneurs. Faune et flore peuvent aussi être de bons marqueurs de l’état des habitats. Attardons-nous donc sur quelques cas emblématiques. « Les espèces phares, ici, ce sont les orchidées, annonce Vincent. Trois ou quatre sont présentes sur le versant côté Vertaizon et sur la pelouse côté Chauriat – le hot spot – on en compte 17 espèces, dont un hybride qu’on ne trouve qu’ici. C’est un site d’importance régionale. »

Les fleurs et le papillon
Pourquoi ici ? « Elles ont dû s’installer à une époque où elles avaient les conditions optimales. Elles devaient être alors un peu partout autour, mais à cet endroit, les conditions sont restées favorables », dit-il. Conditions qui conjuguent plusieurs facteurs qu’il me détaille : « Le micro climat sec et l’exposition, la combinaison de différents milieux, probablement la présence des champignons avec lesquels elles fonctionnent en symbiose, mais aussi des bénévoles motivés, sur place, qui les suivent depuis des années, et des élus ouverts à la préservation… Tout ça fait qu’elles sont encore là. »
Côté faune, rien d’exceptionnel, si ce n’est la présence foisonnante des oiseaux, des insectes, papillons, chauves-souris… Et tout de même, un enjeu sur une espèce menacée : l’azuré du serpolet. Ce petit papillon bleu ne pond ses œufs que sur le thym-serpolet et l’origan, plantes thermophiles présentes sur les coteaux secs du secteur.
« S’il peut passer d’un site à un autre, le jour où un site disparaît par accident, il peut se replier ailleurs. »
Vincent explique : « L’azuré du serpolet est commun sur le puy de Mur et sur le puy Benoît. Il passe par ici pour passer de l’un à l’autre et on a intérêt à conserver des habitats favorables sur les différents coteaux pour qu’il puisse circuler, sachant que son rayon de déplacement est de 2 ou 3 km. S’il peut passer d’un site à un autre, le jour où un habitat disparaît par accident, il peut se replier ailleurs, puis revenir facilement. Sinon, une population peut se trouver isolée et devenir plus fragile. »

Un site bien protégé
Donc, protéger les habitats. C’est là que le Conservatoire d’espaces naturels intervient, mais pas seul. D’abord parce qu’il intervient à la demande de la communauté de communes de Billom Communauté, car les puys de Mur et de Pileyre forment une zone classée Espace naturel sensible d’initiative locale. Et cela avec la bienveillance des propriétaires du site, qui sont principalement trois : les deux communes de Vertaizon et Chauriat, et un propriétaire privé, exploitant agricole. « Ils nous mettent les terrains à disposition et nous laissent faire ; de notre côté, on les tient au courant, on leur fait valider les actions importantes. »

Le site est d’autant mieux protégé qu’il est inclus dans un autre périmètre : celui d’une zone Natura 2000 qui s’étend vers le sud jusqu’aux Turlurons. Gérée jusqu’en 2024 également par le CEN, elle est passée sous la responsabilité du Parc Livradois-Forez, à la suite d’une redistribution opérée par la Région.
« L’avantage du CEN, c’est qu’on est présent depuis longtemps et nous avons un solide réseau de bénévoles. »
Autant de bonnes fées qui se complètent pour apporter leurs bons soins au site. « Les rôles sont clairs et nous apportons chacun quelque chose de différent, explique Vincent Legé. L’avantage du CEN, c’est qu’on est présent depuis longtemps et nous avons un solide réseau de bénévoles, dont ceux qui ont milité initialement pour le classement du site ; nous avons aussi la souplesse d’une structure qui n’est pas liée à des mandats d’élus. Le Parc amène une ‘force de frappe’ d’une autre échelle, l’inconvénient étant qu’on est ici en limite de son périmètre, avec des enjeux qui ne sont pas centraux pour son territoire… Ce qui n’empêche pas qu’il soit présent et assume son rôle. Quant à la communauté de communes, elle a l’assise territoriale et la légitimité qui l’accompagne. Les deux communes concernées sont très engagées aussi. »

| Sur une autre façon de combattre la déprise agricole d’un coteau sec, lire aussi le reportage : « Un outil inédit, des amandiers et des poules pour valoriser la Montagne de la Serre » |
Préserver la diversité
Dans ces conditions, entrer en action apparaît simple et facile. Éviter les dégradations, informer le public, ajouter des clôtures pour matérialiser l’interdiction de circuler en véhicules motorisés… Et assurer un suivi des observations au fil des ans.
« L’idée est de maintenir le plus de milieux naturels différents. »
Une des questions qui peut se poser est celle d’assurer la diversité des milieux et notamment, de préserver des pelouses ouvertes : sans intervention humaine, des sites anciennement ouverts pour l’agriculture puis retournés à la friche peuvent avoir tendance à se refermer, à s’embroussailler, et pour finir, à parvenir à un très uniforme état de forêt. Et c’est alors la disparition des autres habitats, et donc des orchidées, du thym-serpolet, de l’azuré et de nombreuses autres espèces liées à ces espaces.

C’est pourquoi le CEN tente ici – et dans quelques autres endroits – l’expérience de faire pâturer des moutons pour maintenir ces pelouses thermophiles sur une dizaine d’hectares. « Sur les 30 sites de coteaux secs que nous gérons, tous n’ont pas besoin d’être pâturés. L’idée est de maintenir le plus de milieux naturels différents. On le fait là où il y a un projet précis de gestion du site – dans ce cas, les moutons peuvent tenir lieu de débroussailleuse – et si on a l’opportunité d’aider un éleveur, comme c’est le cas ici », détaille Vincent Legé.
Débroussaillage au naturel
En l’occurrence, une trentaine de brebis croisées de mérinos s’activent à brouter les pentes du puy de Pileyre depuis la mi-avril, indifférentes à la robustesse et aux piquants des broussailles naissantes qu’elles engloutissent avec le même entrain que l’herbe tendre. Le petit troupeau est en mission pour plus ou moins trois semaines et sera déplacé ensuite vers un autre site protégé. Il appartient à Sara Benmansour et Pierre Lesens, éleveurs installés depuis deux ans, avec un modèle particulier.

Vincent explique : « Ils font pâturer leurs bêtes uniquement sur des espaces protégés qui ont besoin d’être maintenus ouverts, dans un système de ‘pâturage tournant dynamique’. L’été, ils partent avec leur troupeau dans les Alpes du sud, où ils ont travaillé auparavant. Ils y sont employés comme bergers par un groupement pastoral, ce qui leur fait un revenu complémentaire. »
« C’est aussi réjouissant de favoriser le retour d’élevages dans la plaine. »
Avec toute l’équipe du CEN, il se réjouit de pouvoir aider ainsi des éleveurs à s’installer : « L’accès au foncier est très difficile quand on n’est pas en reprise d’une ferme. Ce système est chouette pour le bien-être animal et pour les espaces naturels. C’est aussi réjouissant de favoriser le retour d’élevages dans la plaine. Autrefois, on avait de la polyculture et les animaux fertilisaient les champs. On est passé à un système de grandes cultures, avec une forte déprise agricole sur les coteaux. Ça fait de la peine : les coteaux se referment et s’uniformisent ; les élevages s’éloignent de la ville et l’approvisionnement vient de plus loin ; les enfants n’ont plus de familiarité avec les animaux… »

L’élevage n’est d’ailleurs pas la seule activité qui peut se redévelopper sur les coteaux secs, et le CEN soutient dans d’autres secteurs des projets viticoles, arboricoles et même, une expérimentation de culture de truffes. Tout cela en tenant compte des projections de changement climatique, dont les espaces thermophiles peuvent constituer des « avant-postes » où expérimenter des évolutions de modèles agricoles.

| Sur un autre modèle de troupeau itinérant, lire aussi le reportage : « Moutons en mission dans la chaîne des Puys » |
La bataille des thermophiles
La préservation de ces espaces, avec la plus grande diversité possible d’habitats, a aussi pour fonction d’accueillir les espèces méditerranéennes qui ont tendance à remonter vers le nord à mesure que les conditions climatiques deviennent plus assommantes. Le problème étant que toutes les espèces ne se déplacent pas au même rythme dans ce marathon, sans parler de celles qui n’y parviennent pas. « Plein d’espèces vont disparaître, parce qu’elles ont un cycle de vie ou de dispersion trop lent », explique Vincent.
« Côté Chauriat, on voit des orchidées se réfugier sous les arbres ! »
Les pionnières ont besoin de trouver plus au nord des habitats favorables, des écosystèmes accueillants où elles pourront fonctionner et s’épanouir. « C’est un enjeu important de préserver des milieux qui fonctionnent de façon autonome… même si ça peut être utile de les aider à impulser une dynamique », ajoute-t-il.
Symboliquement, les Auvergnats ont pu remarquer que les cigales sont déjà présentes au plus fort de l’été. Vincent cite aussi la trigonelle de Montpellier, une petite légumineuse protégée en Auvergne, ainsi que certaines orchidées. La mutation du climat est déjà en marche et il s’avère plus que jamais nécessaire de prendre les mesures pour l’affronter. « Je ne pensais pas le voir aussi concrètement de mon vivant. Côté Chauriat, on voit des orchidées se réfugier sous les arbres ! », s’inquiète Vincent. Un autre enjeu de protection étant la fragilité de ces zones, plus vulnérables aux incendies et à la chaleur.
Cinq jours après mon premier passage sous la pluie, je retourne sur les lieux à la faveur d’une après-midi ensoleillée. Cadrés par leur clôture mobile, les moutons se sont attaqués à un autre carré d’herbe, sous les grands rochers du sommet. Malgré la brume de chaleur, le moutonnement des buttes dans le paysage est beaucoup plus visible. Le bourdonnement des insectes et les chants des oiseaux poursuivent une symphonie exubérante. Pas d’azuré en vue, mais d’autres papillons – machaons, piérides, aurores… – folâtrent un peu partout. Les orchidées ne sauraient tarder à fleurir, des lézards prennent le soleil sur les pépérites. Et il me vient spontanément dans la tête la chanson de Nino Ferrer. « On dirait le Suuuud… »
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé le jeudi 24 avril 2025 (et complété lundi 28). Photos Marie-Pierre Demarty, sauf indication contraire. À la une : l’entrée du site protégé du puy de Pileyre côté nord.
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.