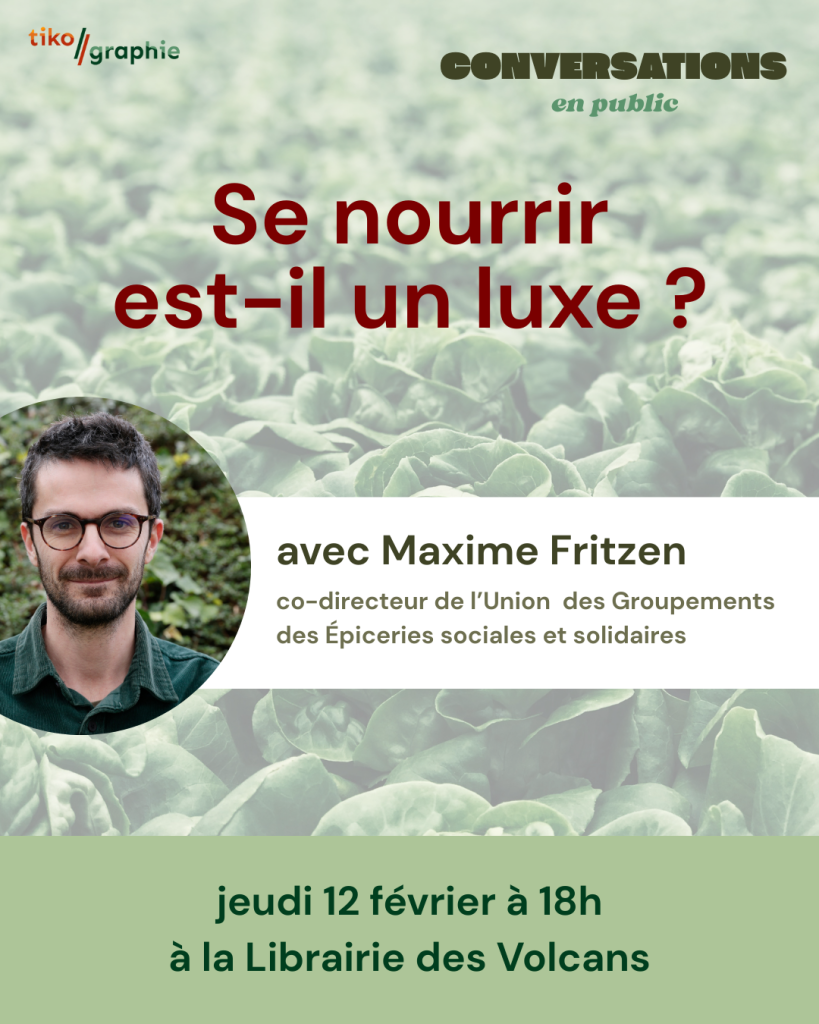Tikographie a besoin de vous
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.
Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.
Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
Vous connaissez cette expression grammaticalement très auvergnate : « C’est pas pire » ?
C’est une sorte de façon pessimiste de dire que c’est mieux, ou au moins pas trop mal. Mais quand même on ne voudrait pas fanfaronner parce que ça reste un mieux un peu fragile, prêt à dégringoler au premier signe de vacillement…
C’est cette expression qui m’est venue spontanément en sortant de mon entretien avec Olivier Baubet.
« Pas pire », parce que c’est pire dans le Jura et les Vosges où les scolytes ont fait un carnage dans les forêts d’épicéas. Pas pire que dans ce Grand Est ou dans le Sud-Ouest où l’on guète les ravageurs en provenance du bout du monde comme sœur Anne du haut de sa tour. Pas pire grâce aux barrières montagneuses qui entourent notre région et retardent les contagions comme elles l’avaient fait pour le phylloxera sur le vignoble local.
Mais pas vraiment mieux, car on sait que le phylloxera a fini par décimer les vignes ici aussi ; on a vu les ormes auvergnats subir le même sort que leurs congénères et les buis disparaître de nos forêts ; on observe la progression inéluctable de la chalarose du frêne. On s’inquiète donc de ce qui pourrait advenir des sapins, des chênes, des douglas pour peu que les phénomènes météo extrêmes ou le réchauffement climatique s’intensifient. Ce qui ne saurait manquer, si vous avez bien lu mon précédent article.
Allez, promis, cet article est le dernier de ma série « le pire et le pas pire ». Je vais retourner à mes belles histoires d’initiatives enthousiasmantes et formidables.
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- Le département du Puy-de-Dôme est le plus gros fournisseur de bois de toute la région Auvergne. Mais différentes problématiques les fragilisent, notamment le dérèglement climatique avec ses événements extrêmes qui s’intensifient, et les ravageurs tels que les insectes, les champignons, les maladies. Ils sont d’autant plus redoutables lorsqu’il s’agit d’organismes exotiques contre lesquels les arbres locaux n’ont pas de défense.
- Globalement, les forêts se portent mieux que dans d’autres régions de France. La plupart des feuillus vont bien pour l’instant, à l’exception des frênes qui commencent à être atteints par la chalarose. Ce sont surtout les résineux qui subissent des affaiblissements passagers ou dépérissements plus inquiétants, pas encore massifs, mais à surveiller de près.
- La surveillance est assurée et coordonnée par le département Santé des forêts rattaché à la DRAAF, mais travaillant directement avec ses homologues des autres régions pour avoir une vue d’ensemble des attaques et de leur progression. Organisé en réseau, ce département recense toutes les attaques et incidents, diffuse l’information auprès des forestiers ainsi que des préconisations pour s’en prémunir, et travaille avec la recherche pour améliorer les défenses.
| Lire aussi le premier volet : « Les forêts ont eu très chaud cet été… C’est grave ? » |
« Le Puy-de-Dôme est le grenier à bois de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le département compte 250 000 ha de forêt, soit 34 % du territoire. On y récolte annuellement 1,3 million de m3 de bois, alors que la Haute-Loire, deuxième département pour la fourniture de bois, en récolte 700 000 m3 et la Savoie, également très forestière, n’en fournit que 250 000 m3 », expose d’emblée Olivier Baubet.
Les forêts productives se situent surtout sur les massifs granitiques, au premier rang desquels le Livradois-Forez, et la Margeride plus au sud en Haute-Loire. Pour la plupart, ces forêts ne sont pas anciennes ; elles résultent de reboisements qui ont commencé après 1945 et se sont poursuivis jusque vers les années 1970-80 : un mélange de déprise agricole, d’appel de la main-d’œuvre vers les usines des villes et de politique de reboisement artificiel orchestrée par l’État, grâce au dispositif du Fonds forestier national.
Outre le Livradois-Forez, la chaîne des puys constitue aussi un massif productif. Le Sancy et les Combrailles complètent le panorama du boisement, mais en paysages plus ouverts, alternant avec des bocages et des prairies.

En termes de plantation, les essences stars ont été le sapin, l’épicéa et le douglas. Sur la déprise agricole, le pin sylvestre a été le premier à recoloniser naturellement, suivi par le sapin qui a besoin de l’ombrage de ses prédécesseurs pour s’épanouir. Le robinier ou faux acacia s’est également développé, notamment sur les coteaux de Limagne, car « cet arbre originaire d’Amérique a été importé pour produire des piquets de vigne », indique mon interlocuteur.
Aujourd’hui, ces forêts d’après-guerre arrivent à maturité pour être récoltées. C’est pourquoi le promeneur peut rencontrer ici et là de spectaculaires coupes à blanc, équivalentes d’une moisson à une échelle de temps et de volume bien différente.
Mon interlocuteur, Olivier Baubet, est le responsable du pôle Santé des forêts en Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis venue lui poser une question simple : comment vont les forêts dans le Puy-de-Dôme ? La réponse, évidemment, est beaucoup plus complexe que la question. Mais avant d’y répondre, faisons connaissance avec ce service de l’État.

Des pluies acides…
Il est créé en 1989 par le ministère de l’Agriculture, à l’époque où la grande affaire en matière de pollutions était la menace des pluies acides. « On leur attribuait tous les dépérissements et on prédisait la mort des forêts, dit le responsable Aura. Ce phénomène, en France, a été surtout prégnant dans les Vosges. Le ministère a senti l’intérêt de se doter d’un réseau de généralistes pour avoir une vision globale et continue de la situation. »
À partir de 2016, le département ministériel a créé des implantations déconcentrées, et est aujourd’hui organisé en six grandes régions. La nôtre est calquée sur la région administrative Aura et son service est installé – grenier à bois oblige – à Clermont-Ferrand, plus précisément dans les locaux de la DRAAF à Marmilhat.
« On leur attribuait tous les dépérissements et on prédisait la mort des forêts. »
Elle est l’une des plus productives de France (avec la Nouvelle Aquitaine). La première pour le sapin pectiné et l’épicéa. Mais elle est aussi, avertit Olivier Baubet, « d’une complexité sans nom », avec des massifs forestiers répartis entre tous les types de régions écologiques ou presque, de la plaine sous influence atlantique dans l’Allier aux forêts méditerranéennes de Drôme-Ardèche, en passant par le Massif central, les Alpes, un bout de Jura représenté par le Bugey…

…au changement climatique
Les pluies acides ayant fait leur temps, l’enjeu actuel se porte sur le changement climatique et le cortège d’effets indésirables sur les étendues forestières. Longtemps on a considéré dans les questions forestières que le climat était constitué de constantes. Aujourd’hui ce n’est plus vrai.
Pour des organismes vivants programmés pour traverser les siècles, c’est gênant. Car le patrimoine génétique des arbres est lié à leur phase d’installation : ils sont adaptés au climat qui règne à l’époque de leurs 30 premières années environ. Tant que le climat est stable, ils peuvent poursuivre leur vie en toute quiétude avec ce bagage génétique.

Mais quand le climat évolue, les arbres les plus anciens sont les plus fragilisés. Cela pose problème notamment pour les forêts dont les arbres sont anciens et tous du même âge, comme on en rencontre dans l’Allier. Contrairement aux futaies irrégulières et mélangées, les ravageurs s’y installent facilement : des insectes, des champignons, des maladies profitent d’un stress de l’arbre, puis se répandent de l’un à l’autre d’autant plus vite que les arbres fragiles sont en forte densité.
Ravageurs à l’affût
Le changement climatique n’est pas uniquement une question de réchauffement et de manque d’eau. Ce sont aussi des épisodes extrêmes. Comme les tempêtes qui peuvent abattre des arbres, ce qui peut encore accentuer les phénomènes. Car « si on modifie le couvert forestier, on modifie le micro-climat et l’impact est plus fort. »
« Il arrive de nouveaux organismes chaque année. »
Une fois l’arbre affaibli, quelle que soit la cause, la porte d’entrée est grande ouverte pour les insectes, champignons ravageurs ou organismes pathogènes qui vont aggraver son cas. Et ses défenses seront particulièrement impuissantes s’il s’agit d’organismes invasifs exotiques : un autre enjeu que les humains ont ajouté pour finir de perturber les forêts. Quand un ravageur est indigène, l’écosystème a pu s’armer pour le réguler. S’il est importé par mégarde d’un autre coin du monde, la forêt qui l’accueille ne connaît pas les moyens de le limiter et rien ou presque ne peut alors l’arrêter.
| Lire aussi l’entretien : « Une chaire pour étudier les extrêmes météo en Auvergne et prévoir les dégâts » |

« Notre région est concernée, dit Olivier Baubet. Il arrive de nouveaux organismes chaque année. » Parmi les derniers visiteurs indésirables, il cite la chalarose du frêne. Ce champignon originaire d’Asie du sud-est nous est arrivé via la Pologne et cause mortalité, dessèchements et fragilités. Et du frêne, notre territoire en compte beaucoup. Dans les bois, les haies, les bocages… Il pourrait bien finir par disparaître de nos paysages.
Inarrêtables
Autre exemple frappant : la pyrale du buis. Cet arbre plutôt méditerranéen est peu présent en Auvergne mais on en rencontre notamment sur les coteaux secs et dans les forêts de plaines. Mais il est naturellement présent, marque le paysage et est aussi répandu dans les jardins ; c’est pourquoi les habitants y sont attachés. Notre région subit depuis l’an dernier une pullulation de pyrale, une petite chenille qui cause de fortes mortalités. « En forêt, il n’y a rien à faire, d’autant qu’il n’y a pas d’enjeu économique. On peut seulement espérer que les buis restants trouvent un jour une parade », commente Olivier Baubet.
« La première des luttes, c’est de ne pas aller chercher des végétaux à l’autre bout de la planète. »
Il cite encore la punaise réticulée du chêne, qui n’est pas encore arrivée en Auvergne mais s’avère « inarrêtable », remontant par le Sud-Ouest et par la vallée du Rhône. Et d’autres ravageurs pour l’instant surveillés de plus loin, comme le nématode du pin, un ver microscopique mais redoutable, en provenance d’Amérique du Nord, qui a récemment débarqué au Portugal.
« La première des luttes, c’est de ne pas aller chercher des végétaux à l’autre bout de la planète », dit le responsable régional de la santé des arbres. Il rappelle le précédent des ormes décimés par la graphiose : « Il y en avait partout dans les alignements d’arbres et les forêts ; ils ont complètement disparu, en tout cas à l’état de grand arbre ; car la souche peut rester vivante et produire une nouvelle cépée avant que celle-ci ne soit à son tour atteinte. »
Les feuillus, ça va
Maintenant que nous connaissons les types de périls à surveiller, tentons donc de répondre à la question initiale : comment vont les forêts dans le Puy-de-Dôme ? N’espérez pas obtenir des chiffres précis ou une cartographie détaillée de dépérissement, qui seraient difficiles à établir. Car les ravageurs de l’arbre, comme nos maladies, sont plus ou moins sévères, vont et viennent, et peuvent difficilement être considérés globalement.

Commençons par dire qu’à l’exception des frênes, la plupart des feuillus se portent plutôt bien. Les châtaigniers ont été victimes d’un chancre qui a fait beaucoup de dégâts partout durant quelques années. Mais bonne nouvelle : l’introduction d’un insecte prédateur a permis de le réguler et de sauver les peuplements, certes peu nombreux dans le Puy-de-Dôme mais très présents dans d’autres secteurs du Massif central.
Rougir sans plaisir
Mais les résineux souffrent. « Le douglas, l’épicéa commun, le pin sylvestre et le sapin pectiné sont les essences qui ont présenté le plus de dommages », résume Olivier Baubet. Passons-les en revue.
Le douglas ? Cette essence, abondamment plantée dans la région, présente des signes de fragilité : les jeunes arbres sont affectés par des phénomènes de rougissement. Ils résultent de conditions météo faisant alterner gels et dégels dans la même journée, avec des nuits de froid intense et des journées ensoleillées. « C’est un aléa assez connu mais qui devient de plus en plus fréquent. Avant, ça se produisait tous les 7 à 8 ans. Dernièrement, c’est arrivé en 2022 et 2025, de sorte qu’un même jeune arbre a pu le subir deux fois », fait observer le responsable du département Santé des forêts. Un signal encore faible qu’il va falloir suivre…

L’épicéa ? Touché par les scolytes typographes, quoique moins dans le Massif central que dans le Grand Est. Une poussée épidémique est survenue dans la séquence de longue sécheresse de 2022-2023, mais l’année 2024 beaucoup plus humide lui a apporté un répit. « On a tout de même perdu des peuplements dans le Puy-de-Dôme et dans le Cantal, et des forêts ont été déstructurées, sur quelques centaines d’hectares », résume Olivier Baubet.
Sapins sous surveillance
Le sapin pectiné ? C’est le résineux local par excellence. Lui aussi a subi de gros dépérissements dans les dernières années sèches, surtout affecté par la sécheresse automnale et par les scolytes qui ont profité de cet affaiblissement pour attaquer. Le Livradois-Forez et les piémonts des massifs ont particulièrement souffert. « En colonisant les zones de déprise agricole, le sapin était peut-être descendu un peu trop bas par rapport aux altitudes qui lui conviennent, ce qui peut expliquer cette sensibilité aux années sèches. Mais il a une bonne capacité de résilience et le répit climatique de 2024 a permis de limiter la casse, en tout cas pour l’instant. »
« Cela signifie qu’on est sur le fil du rasoir. »
À l’échelle du Puy-de-Dôme, c’est cette essence qui fait l’objet de la plus haute surveillance. Une enquête, déjà réalisée en 2021, va être réitérée en 2026 à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes sur cette essence à fort enjeu local. « Il s’agit d’un road sampling. Sur le territoire des mêmes communes qu’en 2021, on fait un inventaire le long des voiries à intervalles réguliers. L’objectif est d’évaluer les pertes de capital forestier : coupes, dépérissements, mortalités. Ce n’est pas représentatif de l’ensemble des massifs mais ça permet de mesurer l’évolution. »

Terminons ce tour d’horizon par le pin sylvestre. Il a subi en 2023 une étonnante sécheresse, hors norme sur un secteur précis : le piémont sud du Livradois, dans un secteur allant d’Auzon à Brioude. Alors qu’au nord et au sud de cette zone, la mortalité a été bien moindre. L’explication a été trouvée en épluchant les bulletins météo de cet été-là. Le 15 août, un orage est venu soulager les arbres en souffrance… mais a contourné cette zone centrale. Et ce seul épisode a suffi à différencier le sort des peuplements de pin. « Cela signifie qu’on est sur le fil du rasoir, relève Olivier Baubet. Dans ce cas précis, un ravageur a amplifié le phénomène, jouant le facteur aggravant. À moins que ce ne soit l’inverse. »
Travail en réseau
Face à de telles menaces, que fait le département Santé des forêts ? Comment s’opère la surveillance ? Pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce service compte un personnel pléthorique de… trois personnes : un responsable, un adjoint et un technicien. Mais ils sont entourés d’un réseau de « correspondants observateurs » issus de trois organismes présents sur le terrain : l’ONF, le CRPF et la DDT, soit 38 personnes, et un sous-réseau plus dense de forestiers qui permet de faire remonter les observations.
Ce réseau pratique ainsi une veille sanitaire pour, dit le responsable du service, « qualifier les incidents » tels que des rafales déracinant des arbres, des attaques d’insectes ou de champignons. Ils peuvent être caractérisés en trois types de facteurs : ceux qui prédisposent, ceux qui déclenchent et ceux qui aggravent les dommages. « Les équipes sont formées à faire des diagnostics précoces », explique Olivier Baubet.

Cette surveillance continue permet d’établir annuellement un bilan aux niveaux départemental, régional et national. « La force du département Santé des forêts est d’avoir un pilotage national qui fait travailler ensemble les services de toutes les régions », souligne le responsable Aura. Ce bilan fait apparaître les signalements d’incidents géolocalisés, sous forme de cartographie. Environ 70 sont repérés chaque année, en plus de ceux qui sont déjà sous surveillance.
« Notre objectif, poursuit-il, est de pouvoir identifier les problématiques, les diagnostiquer, communiquer aux propriétaires forestiers les causes et les possibilités de limiter les impacts. Il est aussi d’apporter une hauteur de vue. » L’état sanitaire des forêts, qui n’a longtemps pas été un sujet central pour les propriétaires forestiers, devient de plus en plus leur problématique principale, précise-t-il.
Les bonnes méthodes
Face à ces perturbations qui fragilisent les essences forestières, les réponses sont délicates mais pas inexistantes. On pense par exemple à l’idée d’introduire de nouvelles espèces plus résistantes au réchauffement : ce sont des recherches en cours, mais qui ne doivent pas s’effectuer à la légère car il s’agit de prévoir l’adaptation d’essences au contexte particulier de notre région, qui plus est dans un climat qui va continuer à changer.
On retrouve aussi sur ce sujet l’autre problématique : les introductions pourraient apporter de nouveaux pathogènes. Notamment, des champignons transmis par le système racinaire tels que le fomès sont à redouter, celui-ci affectant les résineux. « C’est un problème important et d’autant plus délicat à appréhender que nous sommes sur des sols de forêts récentes, anciennement agricoles, dont les écosystèmes fongiques sont complexes », avertit Olivier Baubet.
« Nous sommes sur des sols de forêts récentes, anciennement agricoles, dont les écosystèmes fongiques sont complexes. »
L’attention est aussi portée aux méthodes de gestion et aux pratiques des forestiers, qui jouent un rôle capital. Il s’agit d’améliorer la résilience des forêts en préparant les renouvellements. Permettre un peuplement naturel, diversifier les essences et les âges des arbres offre pour l’avenir les meilleures chances de résistance à la progression des ravageurs et aux aléas climatiques.

Par ailleurs, la surveillance évolue et s’améliore grâce aux techniques nouvelles comme la vision par satellite. « Elle aide à repérer les dégâts des scolytes par exemple. C’est un bon indicateur des principaux problèmes, mais qui doit ensuite être couplé avec une observation sur le terrain pour établir des diagnostics précis. C’est cependant précieux pour repérer les endroits affectés. »
Pas si mal
Le pôle Santé des forêts travaille aussi en partenariat avec le laboratoire PIAF dont les chercheurs, à Clermont, étudient les effets du changement climatique sur les arbres. Une meilleure connaissance des mécanismes de dépérissement permet aussi de faire ou de préconiser des choix plus judicieux, en termes de prévention, d’anticipation ou de défense contre les différentes menaces.
| Lire aussi le reportage : « Comment le PIAF contribue à l’adaptation des arbres » |
La surveillance des crises sanitaires, la mobilisation des acteurs de la forêt, les diagnostics les plus précoces possibles sont finalement les meilleures parades pour limiter au mieux les dégâts.
Néanmoins, dans notre département, Olivier Baubet reconnaît qu’« une certaine proportion de la forêt se dégrade, mais pas tant que ça. » À la différence de massifs comme le Jura où elle est décimée par le scolyte typographe, celle de l’Auvergne, dit-il, n’a pas connu de crise majeure récemment. « C’est une chance », conclut-il. Ajoutons comme Madame Bonaparte mère (mais sans l’accent corse) : « Pourvu que cela dure… »
Reportage réalisé par Marie-Pierre Demarty, lundi 15 septembre 2025. Photos Marie-Pierre Demarty, sauf indication contraire. À la une : une forêt de pins dans le Livradois.
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.