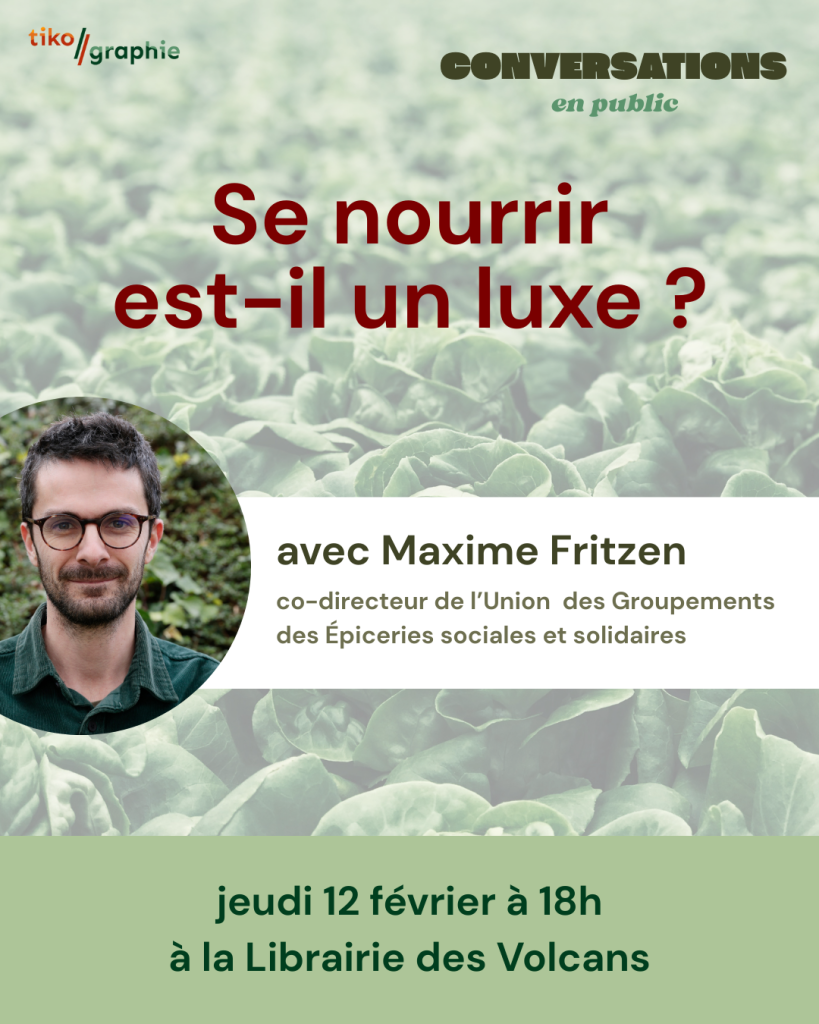Tikographie a besoin de vous
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.
Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.
Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
J’avoue : j’ai une tendresse particulière pour cette partie sud-ouest du Massif du Sancy et son prolongement dans les moutonnements granitiques de l’Artense. Moins connus, plus isolés, plus secrets que les stars de la géologie locale et les pentes aménagées pour les skieurs, ils semblent plus propices à la préservation des milieux naturels.
C’est pour cette raison que j’ai choisi Chastreix-Sancy pour répondre à cette question (entre mille autres) que je me pose : c’est quoi, au juste, une réserve naturelle nationale ?
Cela m’a semblé d’autant plus pertinent que les projecteurs se sont braqués sur ce bout de territoire il y a six mois, à l’occasion d’un spectaculaire incendie (dont je vous parlerai dans le prochain article). Il a suscité beaucoup d’émotion et d’inquiétudes, me confirmant que j’étais loin d’être la seule à avoir une tendresse particulière pour ce coin.
Je vous propose donc pour l’heure de déployer votre carte IGN n°2432ET, de laisser votre chien à la maison et votre imagination en liberté, d’enfiler kway et chaussures de marche et de bien rester sur les chemins. Prenez votre élan : ça va grimper…
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- La réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy, la plus récente et la plus vaste dans le Puy-de-Dôme, est constituée de la vallée glaciaire de la Fontaine salée et des crêtes du Sancy, ainsi que de deux petites vallées du versant nord et la zone de naissance de la Dordogne. Elle regroupe ainsi des milieux naturels très diversifiés, abritant une riche biodiversité : forêts, prairies pâturées, zones humides et tourbières, landes, pelouses d’altitude, rochers et éboulis…
- Traditionnellement les réserves s’appliquaient surtout à préserver les espèces rares. Mais Chastreix-Sancy, pionnière des réserves de montagne, s’oriente vers une autre approche : préserver une mosaïque de milieux naturels avec toutes les espèces qui s’y trouvent, en s’efforçant de réduire le plus possible la pression des activités humaines et en étudiant les écosystèmes dans leur fonctionnement global et dans les interactions entre espèces.
- La stratégie de préservation inclut aussi différentes orientations : augmenter les îlots de vieux arbres en forêt et les arbres-habitats, travailler en bonne intelligence avec la cinquantaine d’éleveurs, canaliser les promeneurs et randonneurs sur des chemins balisés, confortables et entretenus, sensibiliser les locaux et les visiteurs. Cependant d’autres menaces semblent inéluctables, notamment le réchauffement climatique. Alors que les écosystèmes de plus basse altitude auront toujours la ressource de remonter, l’étage subalpin froid est menacé de disparition, avec son cortège d’espèces ou sous-espèces rares, voire complètement endémiques, comme la Jasione crêpue d’Auvergne ou l’Apollon arverne.
Sur la carte, c’est une longue bande de terrain avec quelques boursoufflures. Orientée sud-ouest / nord-est, elle commence, au plus bas, près de la route qui relie Picherande à La Tour d’Auvergne, dans les paysages de l’Artense. Puis elle gravit la montagne. Elle doit sa forme allongée à une belle vallée glaciaire : des zones humides et boisées dans sa partie basse et vers le haut, le cirque de la Fontaine salée, qui vient se heurter aux fortes pentes du Sancy.
Les boursoufflures de la carte, ce sont les montagnes dont les contours de la zone suivent grosso modo les crêtes, rebondissant de sommet en sommet et prenant soin d’éviter le plus possible les trois domaines skiables. Comme le Massif central, la réserve naturelle de Chastreix-Sancy culmine à 1885 m, puisque le sommet du Sancy se trouve sur le tracé de ces limites. De même que, vers l’ouest, ceux du puy de Clergue, du puy de Chabane, du mont Redon et enfin du roc de Courlande, ce vestige volcanique très pointu avec ses statues pieuses jalonnant un ancien pèlerinage.
Le fond de la vallée glaciaire est irrigué par d’innombrables petits ruisseaux que la fonte des neiges fait grossir au printemps et qui s’en vont alimenter la Trentaine et la Gagne. Des prairies, des hêtraies-sapinières, des landes. Et en plein milieu, faisant tâche sur la carte et dans le paysage, une plantation d’épicéas incongrue.

Plus haut vers les crêtes, ce sont des pelouses plus rases, des rochers à nu, des éboulis, des petits vallons secondaires. Côté nord, la réserve s’approprie un bout de l’autre versant, pour inclure les vals d’Enfer et de Courre qui vont rejoindre la Dordogne au pied des pistes du Mont-Dore. Elle va aussi chercher, en traversant les pistes, la tourbière d’où naît un des deux bras de la Dordogne. Au nord-est enfin, elle flirte avec sa sœur aînée, la réserve de Chaudefour, dans un jeu complexe de délimitations, et elle englobe le puy de Paillaret qui surplombe Super-Besse.
| Sur la haute vallée de la Dordogne, lire aussi : « Haute-Dordogne #1 : une rivière sous contrainte » et à la suite, les 3 autres volets de la série sur le projet de sa renaturalisation. |
Le droit chemin
Dans ce morceau de montagne de 1895 hectares, aucune construction habitée. Il ne reste que quelques burons plus ou moins en ruine. Mais une partie des forêts est encore exploitée et les vaches d’une cinquantaine d’éleveurs pâturent dans le périmètre. Le réseau des chemins, contournant tout de même le cirque glaciaire mais incluant un bout du GR30, accueille et canalise autant que possible les randonneurs et visiteurs.

À part ça, la zone est parcourue, surveillée et choyée par 4 à 8 gardes selon la saison, dont 4 assermentés pour vous verbaliser si vous faites des bêtises – ou au moins vous sermonner, ou vous ramener dans le droit chemin balisé. C’est l’équipe dépêchée par le parc naturel régional des Volcans pour gérer la réserve. Gestion qui a été confiée au parc par l’État, puisqu’il s’agit d’une RNN ou réserve naturelle nationale : notre département en compte quatre, les autres étant la vallée de Chaudefour (la plus connue), les Sagnes de La Godivelle (la plus ancienne) et le Rocher de la Jaquette (la plus secrète, dans le Cézallier). Créée en 2007, Chastreix-Sancy est la plus récente. Elle est aussi la plus vaste.
« À l’échelle nationale, elle est moyenne-grande. L’État cherche à avoir des réserves de plus en plus grandes pour pouvoir mieux protéger. Par ailleurs, la tendance est aussi à aller vers la protection de zones plus anthropisées, avec des enjeux socio-économiques, où la préservation des milieux naturels est moins simple », explique Thierry Leroy, le conservateur de la réserve.

Préserver la mosaïque
Protéger, gérer, sensibiliser. La mission du conservateur et de son équipe est triple, comme c’est rappelé en toutes lettres sur la Maison de la réserve, au centre du village de Chastreix où je le rencontre. Les gardes veillent sur les 8500 espèces de faune et de flore identifiées dans sa riche biodiversité – sans compter celles qui ne le sont pas encore, dont certaines surgissent parfois au détour d’un inventaire.
Leur feuille de route est inscrite dans un plan de gestion sur dix ans, ce qui n’est pas original. Mais ce que contient le nouveau plan décennal, mis en œuvre à partir de 2022, l’est davantage.

Thierry Leroy explique en quoi il est novateur : « Depuis une quarantaine d’années, l’approche dominante se préoccupe de la protection des espèces à valeur patrimoniale, c’est-à-dire les plus rares. Mais les réserves alluviales, puis les réserves littorales ont été pionnières d’une nouvelle façon d’envisager la protection, encore peu en usage dans les réserves de montagne : il s’agit de s’intéresser à des milieux et à leur fonctionnalité, ce que nous commençons à mettre en œuvre ici. Nous allons être attentifs à préserver une mosaïque de milieux et à leur assurer un haut niveau de naturalité. Et cela sur l’ensemble de la réserve, quelles que soient les espèces présentes. C’est cette mosaïque qui sera garante de la biodiversité. »
« L’approche dominante se préoccupe de la protection des espèces à valeur patrimoniale, c’est-à-dire les plus rares. »
L’objectif est donc de préserver la diversité de ce patchwork où alternent des zones aux profils divers, chacune abritant un écosystème particulier : zones humides et tourbières, prairies d’élevage, forêt, landes, étage subalpin ouvert et froid… « Une étude a été lancée pour définir la bonne échelle d’observation de la mosaïque, poursuit-il. Elle va évaluer le nombre de patchs, les lisières qui doivent faire l’objet de notre attention et les corridors qui peuvent permettre à la faune de circuler d’un patch à un autre du même type. »
Le bon dosage des patchs et leur suivi permettront de vérifier la stabilité de la mosaïque. Cette alternance de milieux divers favorise la préservation de la biodiversité : si les conditions environnementales ou climatiques font disparaître un type d’habitats, les espèces auront de nombreuses options pour se réinsérer dans un écosystème voisin.

Réduire la pression
Autant l’équipe de la réserve doit se préoccuper de simplement maintenir la mosaïque, autant il est convenu que la naturalité peut dans certaines zones être améliorée. La naturalité ? L’idée est de réduire le plus possible les perturbations créées par l’humain. « Mais c’est difficile à mesurer », reconnaît le conservateur.
« Nous aimerions de plus en plus faire des liens entre ces inventaires, pour mieux comprendre le fonctionnement des milieux. »
L’indicateur le plus simple, explique-t-il, c’est de quantifier la pression des activités humaines : fréquentation, quantité de bétail présent dans les pâtures, coupes forestières… Pour aller plus loin, le plan prévoit aussi de mesurer l’état des populations de la faune et de la flore. « Pour cela, nous effectuons ou faisons effectuer régulièrement des inventaires, sur des cortèges d’espèces. Par exemple on va inventorier tous les papillons présents dans la réserve. Jusqu’à présent, nous réalisions des inventaires pour améliorer les connaissances. Maintenant nous ajoutons l’objectif de mesurer la naturalité. »
Jusqu’à présent aussi, explique-t-il, les inventaires se réalisaient « en silo », plus ou moins espèce par espèce en fonction de la spécialisation des naturalistes sollicités. « Nous aimerions de plus en plus faire des liens entre ces inventaires, pour mieux comprendre le fonctionnement des milieux. »

Pelouses et vieilles forêts
C’est d’abord dans les forêts que la naturalité doit être amplifiée. Elles constituent 22 % de la réserve. Et si la moitié environ sont des forêts anciennes qui n’ont pas été exploitées depuis 200 ans, d’autres espaces méritent d’être gérés de façon moins intensive. Il s’agit de laisser des arbres se développer, grossir, vieillir, mourir et se décomposer sur place : ce qu’on appelle des îlots de sénescence, qui favorisent une riche biodiversité.
« L’originalité, c’est qu’on a déterminé une plus forte densité d’îlots de sénescence. »
Deux secteurs principaux répondront à cette fonction, dont le fond du cirque de la Fontaine salée, auxquels s’ajoutent d’autres petits patchs disséminés sur la réserve. Les corridors pour passer de l’un à l’autre sont constitués d’« arbres habitats » qui sont marqués pour être préservés. « L’originalité, c’est qu’on a déterminé une plus forte densité d’îlots de sénescence que ce qui se pratique habituellement, en nombre et en surface, et également une plus grande densité d’arbres habitats, à raison de 7 à 9 par hectare », précise Thierry Leroy.
Dans la continuité de cet objectif, un travail de longue haleine est entrepris sur la plantation d’épicéas, qui a été acquise et classée Espace naturel sensible par le Conseil départemental. L’objectif est de diversifier peu à peu les milieux dans cette zone très uniforme de 60 ha, et de faire disparaître à terme cette essence pas du tout locale qui appauvrit la biodiversité sous sa futaie.
| Pour mieux comprendre l’importance des vieux arbres et des îlots de sénescence, lire aussi le reportage : « Voyage au cœur d’un îlot de vieux bois dans le Livradois » |

Autre piste d’amélioration : les milieux ouverts. Ils peuvent être ouverts grâce aux troupeaux – de vaches principalement. D’autres sont ouverts naturellement et non pâturés, notamment dans le cirque de la Fontaine salée et sur l’étage supérieur, dit « subalpin », au-dessus de 1450 m. Ce sont des pelouses à haut degré de naturalité et des landes. On trouve ailleurs d’autres petites zones disséminées, auxquelles il faut ajouter les tourbières et zones humides du bas de la réserve. Ces milieux ouverts existants sont préservés de la pression des troupeaux car ils sont trop froids, trop pentus ou trop humides. « Il faudrait étendre ce type de milieux non exploités et ce n’est pas facile car cela supposerait de restreindre les zones utilisées pour l’élevage », commente Thierry Leroy.
En bonne entente
De fait, l’équipe préfère entretenir une bonne entente avec les agriculteurs plutôt que d’imposer des mesures qui fâchent. Chacun y trouve son compte. Les éleveurs apprécient l’interdiction des chiens dans la réserve, les financements de mesures agro-environnementales, ou l’accompagnement technique que peut apporter la réserve, par exemple pour la mise en place d’abreuvoirs qui vont faciliter la protection des cours d’eau.
« Nous sommes sur place, nous les connaissons tous et ils savent que si nous remarquons quelque chose d’anormal sur un troupeau, on appellera le propriétaire », cite le conservateur pour illustrer la bonne entente.
« Nous sommes sur place, nous les connaissons tous. »
Ces bons rapports font passer plus facilement les quelques contraintes sur le respect des lieux, qui se résolvent le plus souvent dans l’échange pour trouver une solution. Exemple : pour diminuer la pression du troupeau sur une grande parcelle dans la vallée, la réserve a proposé à l’éleveur de la diviser pour pratiquer un pâturage tournant et permettre à la prairie de se reconstituer quand les vaches sont de l’autre côté de la clôture. « Il a accepté facilement car il en avait le projet mais repoussait tout le temps la mise en œuvre. Du fait qu’on lui en parle et qu’un financement était possible, ça l’a décidé. »
Inquiétudes sur le climat
Reste un sujet d’inquiétude : la vulnérabilité au changement climatique. La réserve a été en 2021-2022 un site test pour élaborer au plan national une méthodologie de diagnostic de cette problématique pour les réserves. « Nous avons été parmi les précurseurs », souligne Thierry Leroy.
« À cela s’ajoute le niveau d’enneigement : on a perdu 11 jours en moyenne annuelle. »
Il explique : « Aujourd’hui on est incapable de dire si on préservera sur le long terme tous les milieux présents. Les études à ce sujet ont commencé dès 2015. À cette époque, on avait mesuré que la moyenne des températures des 25 dernières années avait augmenté de 0,9°C par rapport à la moyenne des 25 précédentes. Dix ans plus tard et en divisant la période en deux fois 30 ans, l’augmentation est de 1,2°C. À cela s’ajoute le niveau d’enneigement : on a perdu 11 jours en moyenne annuelle sur cette période. » Il se confirme donc que le changement climatique, ici comme ailleurs, est déjà bien à l’œuvre.
Le nouveau plan stratégique fait de l’anticipation de ces changements un des axes forts de la gestion de la réserve. Mais les écosystèmes les plus froids – crêtes et petites zones restant enneigées aux beaux jours – semblent particulièrement menacés.

Documenter la perte
« Tout ce qui est lié aux milieux froids va être impacté, voire va disparaître », poursuit le conservateur. D’où l’importance de conserver le plus possible la mosaïque et de réduire la pression humaine pour freiner les impacts. Mais, ajoute-t-il, « on sait qu’avec le réchauffement, les espèces vont remonter en altitude pour trouver les conditions qui leur conviennent. Et on a fait le deuil des espèces d’altitude, qui ne pourront pas monter plus haut. Elles sont vouées à disparaître. »
Même problématique pour l’écosystème des combes à neige, ces petits bouts de terrain qui restent tardivement enneigés au printemps, et accueillent une végétation spécifique. « Nous les étudions par des relevés très précis de la végétation et des papillons, de l’enneigement, de la température. Mais elles fondent de plus en plus tôt et vont finir par disparaître. En quelque sorte, il s’agit de suivre et documenter la perte. »
« On a fait le deuil des espèces d’altitude, qui ne pourront pas monter plus haut. Elles sont vouées à disparaître. »
Il va falloir se résoudre aussi à voir disparaître à plus ou moins long terme des espèces emblématiques des crêtes, voire totalement endémiques comme la Jasione crépue d’Auvergne, une sous-espèce, n’existant nulle part ailleurs, de cette petite fleur mauve de montagne. D’autres plantes, des oiseaux ou des papillons sont menacés. « On a recensé plusieurs centaines d’espèces de milieux rares, qu’on s’évertue à préserver », insiste Thierry, qui soulève alors l’autre problématique : celle de la fréquentation.


200 000 perturbateurs
Car 200 000 personnes partent chaque été à l’assaut du Sancy : la gageure est énorme, sauf à vouloir mettre la montagne sous cloche, ce qui est exclus. « Au début, c’était un bazar monstrueux, se souvient le conservateur. Les sentiers partaient dans tous les sens, sans aucune organisation, avec beaucoup de dégradations. Ça a été un des premiers gros chantiers. Aujourd’hui, on en récupère les bénéfices. »
L’équipe de la réserve est même intervenue hors de son périmètre et de son rôle pour parvenir à un schéma de circulation cohérent et une canalisation des flux de visiteurs sur certaines zones, pour préserver les autres. « Nous avons fermé 30 km de sentiers et il en reste environ 80 km, que nous avons rendus confortables. Globalement, c’est respecté. Aujourd’hui on aimerait pouvoir laisser l’entretien de ces circulations à ceux dont c’est la compétence », résume-t-il.
« L’originalité est d’avoir ici tous les types tourbeux existant dans le Massif central. »
Car la maintenance de ces circulations occupe encore une centaine de journées de travail par an. Et l’équipe de la réserve a encore beaucoup d’autres chats à fouetter (au sens figuré, hein !). Par exemple pour veiller sur les quelque 200 hectares de tourbières d’une rare richesse : « L’originalité est d’avoir ici tous les types tourbeux existant dans le Massif central, avec des milieux et des espèces rares. » En accord avec les éleveurs, certaines ont été encloses pour éviter leur dégradation par le piétinement des vaches, comme celle du Paillaret qui constitue le plus haut marais du Massif central.

Sensibiliser
Ce n’est pas encore tout. Les gestionnaires de la réserve ont aussi à cœur de la faire connaître et accepter par les locaux – ce qui semble plutôt réussi – et de sensibiliser, un travail de plus longue haleine et de perpétuel recommencement.
Fête annuelle, interventions scolaires, panneaux d’information, « enrôlement » de bénévoles sur des chantiers participatifs ou de professionnels du tourisme pour relayer infos et bonnes pratiques… « On y passe beaucoup de temps et d’énergie », souligne Thierry Leroy.
Voilà (en résumé !) le quotidien de la gestion d’une réserve naturelle. Encore faut-il que ce quotidien ne soit pas perturbé par un événement inattendu. Par exemple ? Un gros incendie au sortir de l’hiver, comme celui du 7 avril dernier sur les pentes du mont Redon. Mais gardons cet épisode pour le prochain article, car il y a plein d’enseignements à en tirer…
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé jeudi 28 août 2025. Photos Marie-Pierre Demarty, sauf indication contraire. À la une : Vue des crêtes du Sancy depuis le puy Gros – Photo Parc des Volcans d’Auvergne
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.