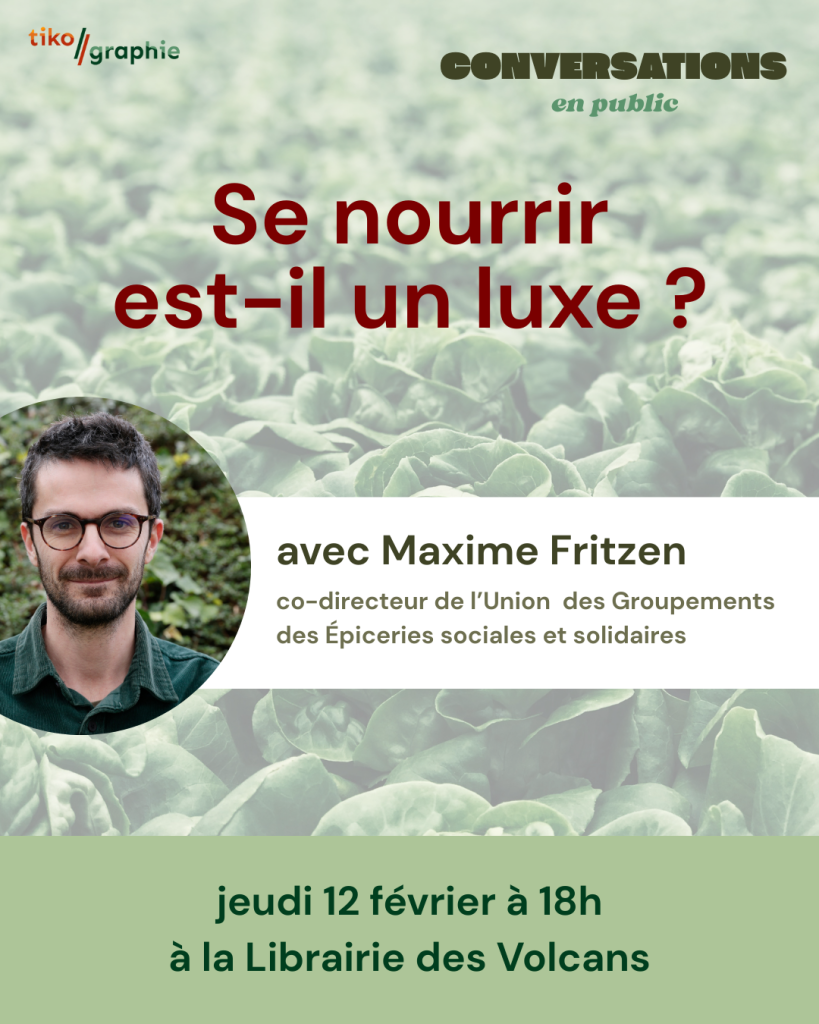Tikographie a besoin de vous
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.
Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.
Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
C’est le dernier volet mais il fallait bien mettre cet aspect en avant : renaturer une rivière, si on le fait intelligemment, ce n’est pas juste renaturer une rivière. C’est aussi regarder autour ce que ça produit et ce que ça décale dans la vie de toute une vallée, et impliquer tous ceux qui vont être concernés. Qu’ils soient des acteurs publics ou privés, des habitants ou des touristes, des plantes, des animaux…
On comprend alors que tout est imbriqué, et qu’il va falloir aussi déplacer des parkings et éteindre des réverbères, dévier des skieurs ou discuter avec des hôteliers, soigner l’accueil des randonneurs, peut-être accueillir d’autres types de visiteurs…
Quand toutes les parties prenantes s’accordent au sens à donner à l’action, le cap à suivre devient clair comme l’eau des sources du Sancy.
Et encore, j’aurais pu détailler d’autres aspects du projet, comme la façon dont les collectivités profitent de la reconfiguration du barrage pour repenser leur stratégie énergétique. Mais on aura le temps d’y revenir. On a sept ans exactement…
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- Le projet Dorsancy va au-delà des opérations prévues directement sur la rivière. Les parties prenantes ont pris en compte tous les aspects qui pouvaient avoir un lien avec la rivière ou être la conséquence de la revalorisation de la Dordogne, dans un véritable projet de territoire cohérent et ambitieux, qui se traduit par une multiplicité de partenaires aux compétences complémentaires.
- Par exemple autour du tourisme : les travaux vont modifier le fonctionnement de la station, tout en la rendant plus compatible avec les enjeux environnementaux. La rivière sera par ailleurs valorisée dans la perspective du tourisme d’été et de pleine nature qui se développe. Un itinéraire de randonnée le long de la rivière, aujourd’hui fractionné, sera complété pour proposer une grande itinérance du Mont-Dore jusqu’à Argentat en Corrèze.
- Entre autres partenaires, le parc des Volcans a amené dans le projet ses compétences et ses propres sujets. Outre la restauration de la tourbière qui donne naissance à l’un des deux torrents formant la Dordogne, il prendra en charge le programme de concertation et de sensibilisation des habitants, ainsi qu’une étude et des préconisations pour améliorer la trame noire de façon fine et adaptée aux besoins.
| Articles précédents : « Haute-Dordogne #1 : une rivière sous contrainte », « Haute-Dordogne #2 : chantiers en cascade » et « Haute-Dordogne #3 : un projet exceptionnel » |
« L’idée était d’amener tout le territoire à réorienter les trajectoires en se basant sur les enjeux de la rivière », soulignait dans le précédent épisode Roland Thieleke, directeur d’Epidor, l’établissement public gestionnaire de la Dordogne et chef de file du projet Dorsancy. Projet que j’ai présenté d’abord sous un angle renaturation de la rivière.
Mais cet aspect est un point de départ. Autour de ce cœur de projet se greffent tout un tas d’aspects liés à la reconsidération du cours d’eau, qui méritent cette qualification de « réorientation des trajectoires. »
Un axe fédérateur
Car remettre la Dordogne au centre des attentions du territoire, c’est ouvrir de nouvelles perspectives : en termes d’image et de tourisme, de priorités d’aménagement, de cohésion et de robustesse face aux crises climatiques et environnementales. Une identité liée à la vallée de la Dordogne apporte un potentiel bien différent – et pourquoi pas complémentaire – à celle du ski et du thermalisme.
Crystèle Maitre, secrétaire générale de la communauté de communes Massif du Sancy, explique comment les représentants de cet espace intégrant les versants nord, sud et est du massif ont appréhendé cet enjeu : « Le projet apparaît pour nous exceptionnel car il est porté par la communauté de communes alors qu’il concerne seulement deux de nos vingt collectivités, mais tous les élus ont compris le bénéfice que pourrait tirer l’ensemble du territoire à mettre en avant l’image de marque de la Dordogne et à faire connaître ses sources. »
« Il est porté par la communauté de communes alors qu’il concerne seulement deux de nos vingt collectivités. »
Le tour de table financier reflète lui aussi l’intérêt très partagé que lui accordent des financeurs aussi bien locaux et régionaux qu’européens. Si l’Europe, à travers le programme LIFE, apporte 36% des 13,7 millions d’euros du budget total, et l’Agence de l’eau Adour-Garonne presque autant, le reste se partage entre une participation symbolique du Département du Puy-de-Dôme et de l’Ademe, et une part significative des porteurs de l’action, publics ou privés, comprenant Epidor, les communautés de communes Massif du Sancy et Dômes Sancy Artense, le parc des Volcans d’Auvergne, ainsi que les deux entreprises respectivement propriétaire et gestionnaire du barrage de La Bourboule, Soprelec et Energialys.
Mais parler de l’aspect financier du projet ne rend pas justice à sa cohérence et à sa complexité, qui lui donnent la dimension d’une belle feuille de route pour le territoire. Pour mieux en cerner la richesse, entrons dans les diverses portes qu’il ouvre.

Pouvoir accueillir
Une première question se pose : comment poursuivre l’activité de la station de sports d’hiver, moteur économique de la haute vallée, tout en remettant en valeur la rivière qui a l’impertinence de naître au beau milieu des pistes de ski ? Et en plusieurs sources en plus !
On a vu dans les précédents articles comment le bas des pistes va être transformé pour remettre au grand jour l’écoulement de la Dordogne et du ruisseau d’Enfer, ainsi que les implications sur l’organisation de la circulation – aussi bien en véhicules que sur les skis. Ce qui impliquera sans doute aussi un peu de pédagogie à faire auprès des skieurs et de toutes les parties prenantes de la station. Mais aussi un peu plus d’attrait et de naturalité pour les touristes de l’été. Même si les transformations imposées par la disparition progressive de la neige se font pas à pas, la prise en compte de l’accueil estival revêt forcément un peu plus d’importance.
« Il faut trouver un équilibre entre les aménagements pour le tourisme et l’impact sur les milieux naturels. »
C’est pourquoi les porteurs de Dorsancy ont compris l’intérêt d’associer les parties prenantes à la démarche. Directeur de l’office de tourisme du Sancy, Luc Stelly explique en quoi il apprécie celle-ci : « C’est intéressant d’être associé au projet au début, car on peut essayer d’imaginer les comportements des visiteurs et d’anticiper les possibilités de dégradation. On va pouvoir s’approprier le projet, le faire comprendre. Il y a eu des périodes où on avait moins de concertation et cette approche donne du sens à des projets collectifs. »
Car il s’agit non seulement de bien accueillir les touristes de l’hiver, mais aussi ceux de l’été : « De plus en plus de touristes viennent pour le côté nature et pour le besoin de fraîcheur ; ce projet va dans le sens de leur accueil, poursuit-il. Il faut trouver un équilibre entre les aménagements pour le tourisme et l’impact sur les milieux naturels, car les touristes sont souvent de milieux urbains et n’ont pas forcément la culture du respect de la nature. Les aménagements de sentiers permettent de limiter les cheminements et le piétinement, de même qu’il est important de bien penser la place et la dimension des parkings, qui contribuent à réguler la fréquentation des lieux. Il faut imaginer des aménagements doux. »
| Sur les problématiques du tourisme, découvrir aussi la synthèse et le podcast de notre rencontre, à laquelle participait Luc Stelly : « En tourisme aussi, y’a plus d’saison » |
Tourbière à restaurer
Restons du côté du domaine skiable. Nous sommes passés un peu vite sur le tout premier chantier en amont, mais y revenir permet de comprendre la logique de travail avec l’un des partenaires : le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, qui s’est impliqué, m’apprend Elodie Mardiné, chargée de mission du parc, « de façon naturelle, là où nous pouvions proposer des compétences complémentaires à celles des autres porteurs des actions et où nous étions en continuité de nos propres actions. »
« Nous avons identifié que la tourbière fonctionne mal, notamment en raison de l’impact du ski. »
Les tourbières étant un sujet central pour le PNR, celui-ci a eu à cœur de prendre en charge ce chantier de la source de la Dore, d’autant plus qu’une partie de la zone se trouve dans le périmètre de la réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy, dont il est gestionnaire. Et surtout, les tourbières et leur capacité incomparable à retenir l’eau représentent un enjeu dans le contexte du dérèglement climatique qui mérite qu’on agisse pour leur préservation.

« Nous avons identifié que la tourbière fonctionne mal, notamment en raison de l’impact du ski : il provoque une érosion des pentes dont les dépôts sont entraînés dans la tourbière. Tant qu’on n’a pas un diagnostic précis, il est difficile de tout expliquer et de connaître précisément les conséquences, mais on se fie aux différences d’aspect de la végétation, qui révèlent des dysfonctionnements. Nous devrons mener une étude pour mieux le comprendre et nous devrons probablement intervenir sur le bassin versant immédiat, autour de la tourbière, pour limiter cette érosion », explique Elodie Mardiné.
Si le parc intervient à d’autres niveaux du projet, la conciliation entre préservation du milieu naturel, mise en valeur de la rivière et activité touristique intervient à un autre endroit du projet, qui fait entrer en scène un autre acteur du territoire.
Raccorder les itinéraires
Car depuis trois épisodes, je vous parle d’un projet qui concerne les 12 premiers kilomètres de la rivière, des sources jusqu’au premier barrage, entièrement inclus dans le territoire du Mont-Dore et de La Bourboule, mais ce n’est pas tout à fait juste. Une facette du projet se prolonge en aval, chez les voisins de la communauté de communes Dômes Sancy Artense. Ce qui explique la présence de celle-ci dans la liste des acteurs-financeurs.
Sa part dans le projet ? Prolonger le « sentier des sources », une randonnée aujourd’hui cantonnée dans le tronçon entre Le Mont-Dore et La Bourboule, qui fera aussi l’objet d’améliorations et de prolongements de la part de la communauté de communes Massif du Sancy dans son propre périmètre. Pour Dômes Sancy Artense, la logique de cette participation s’inscrit à la fois dans sa compétence de promotion du tourisme et celle, optionnelle, de la mobilité.
« Nous avons beaucoup de linéaire de randonnée, mais surtout des petites boucles. »
Isabelle Coulon, chargée de mission tourisme à Dômes Sancy Artense, explique la philosophie de ce nouvel itinéraire et de l’implication de la com’ com’ dans le projet Dorsancy : « Notre territoire se situe entre deux itinéraires de randonnées le long de la Dordogne : en amont, le sentier des sources, et en aval, une itinérance intitulée ‘Itinérêves, de villages en barrages’, qui va de Singles à Argentat. L’idée est de relier les deux en complétant par un tronçon sur les communes de Saint-Sauves et Avèze, passant par les gorges d’Avèze. Ce raccordement permettra de proposer une itinérance longue et sera très intéressant pour mettre en valeur la haute Dordogne. »
Et même si Dômes Sancy Artense a été intégré tardivement dans le projet, l’intercommunalité y trouve aussi du sens par rapport à son propre projet tourisme. Isabelle Coulon poursuit : « Nous avons beaucoup de linéaire de randonnée, mais surtout des petites boucles, qui n’ont pas varié depuis longtemps. Nous avons le projet de les relier dans un schéma cohérent, pour pouvoir proposer des itinérances longues et mettre en valeur les producteurs et commerçants locaux le long de ces parcours. Un itinéraire le long de la Dordogne y aura toute sa place, car pour l’instant nous mettons peu en avant l’image de cette rivière. »

Le projet Dorsancy arrive à point nommé, car la tâche ne sera pas simple, notamment dans la partie boisée et encaissée que constituent les gorges d’Avèze. « Le principe sera de s’appuyer le plus possible sur des chemins déjà existants, quitte à s’éloigner parfois un peu de la rivière. Mais le repérage sera complexe et il faudra parfois négocier aussi avec des propriétaires privés », dit-elle.
Et elle ajoute cette dernière remarque, qui s’inscrit aussi dans l’esprit collaboratif de Dorsancy : « Nous avons l’habitude de travailler ensemble avec la communauté de communes Massif du Sancy, notamment sur le sujet des activités de pleine nature. Ce projet se met donc en place assez naturellement. »
| Sur une autre problématique de randonnée, lire aussi le reportage sur le versant sud du Sancy : « Des joëlettes pour randonner en solidaire » |
Embarquer les habitants
Le tourisme – d’hiver ou d’été – c’est bien, mais les gens qui vivent dans la vallée à l’année sont aussi à prendre en compte et le projet Dorsancy ne les oublie pas. C’est là qu’on retrouve un des rôles du parc des Volcans, sur une tout autre facette que l’intervention sur les tourbières. « Cet aspect nous tient à cœur aussi, car nous souhaitons fonctionner de moins en moins en projets ‘descendants’ et un collègue s’est formé spécifiquement sur l’animation de projets participatifs », explique Elodie Mardiné, qui souligne que « dans un projet européen, on ne peut malheureusement pas engager la concertation avant d’avoir déposé et validé un projet déjà bien travaillé ; mais il est important d’organiser ce partage le plus en amont possible. »
« Il est important de ne pas bâcler cette étape. »
Même un peu plus tardivement, il s’agira, explique-t-elle, « d’expliquer les désordres constatés et pourquoi les politiques publiques ont voulu s’en emparer, comment le projet va se dérouler, ce qu’il va apporter aux habitants et à leur cadre de vie, et de faire comprendre quelles sont les marges de manœuvre pour prendre en compte les attentes et questions qu’ils exprimeront. »

Faire en sorte que les habitants et les acteurs socio-économiques s’emparent du projet, qu’ils visualisent mieux ce que peuvent amener des berges plus accueillantes ou la fraîcheur que dispensera une rivière mieux intégrée à l’espace urbain, décrisper les éventuels points de tension… Les échanges, explique encore Elodie, se feront en plusieurs rencontres publiques de concertation avec les habitants des deux communes, « et on fera sans doute aussi des actions de sensibilisation plus simples avec les territoires plus en aval qui sont tout de même concernés », poursuit-elle. Tout cela probablement à partir de début 2026, après la phase de calage en cours, et « pour six mois à un an, car il est important de ne pas bâcler cette étape. »
Ce qui se trame la nuit
Le troisième point d’intervention du parc se situe à la convergence de la protection des milieux naturels, du cadre de vie des habitants et de la réflexion sur les aspects énergétiques qu’il faudrait encore aborder et qui rebouclent avec la question du barrage hydro-électrique. Et même de la mobilité.
Il s’agit de la trame noire… ou comment perturber le moins possible la faune – qu’elle soit diurne ou nocturne – qui se trouve très perturbée par notre manie d’éclairer la nuit et de ne pas nous plier au rythme naturel d’alternance du jour et de la nuit. « Nous avions réalisé un diagnostic à l’échelle du parc, d’où il ressortait que le secteur des stations de ski conservait une forte luminosité en continu toute la nuit, explique Elodie Mardinié. C’est pourquoi nous avons proposé ce sujet, qui concerne d’ailleurs directement la rivière car il reste des ponts où l’interdiction d’éclairer un cours d’eau n’est pas totalement respectée. Il s’agirait d’étudier finement les choses et de voir au cas par cas comment améliorer les modes d’éclairage, les horaires, et prendre en compte les besoins et les craintes… »
« Il ressortait que le secteur des stations de ski conservait une forte luminosité en continu toute la nuit. »
Expliquant les motivations du parc des Volcans dans ce projet, elle exprime une conclusion qui pourrait sans doute être reprise par l’ensemble des partenaires : « Ce qui nous a intéressés dans ce projet, c’est son aspect holistique, qui prend en compte des angles différents mais tous liés entre eux, avec une vraie cohérence. Cela nous servira aussi de vitrine, à l’échelle du parc, pour engager d’autres territoires dans des projets similaires. » Ce qui tombe bien, car le dernier axe de Dorsancy, passage obligé pour un projet pilote, est justement dédié à la dissémination de l’expérience.
Et pour savoir ce qui aura fonctionné, manqué la marche ou dépassé les ambitions, rendez-vous en août 2031 : échéance prévue pour la coupure globale du ruban.
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé le mercredi 9 avril 2025 (complété ensuite par divers entretiens). Photos Marie-Pierre Demarty, sauf indication contraire. À la une : les équipes d’Epidor, de la communauté de communes Massif du Sancy et (à droite) Luc Stelly, directeur de l’office de tourisme, au pied de la station de ski lors de la visite de terrain du 9 avril.
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.