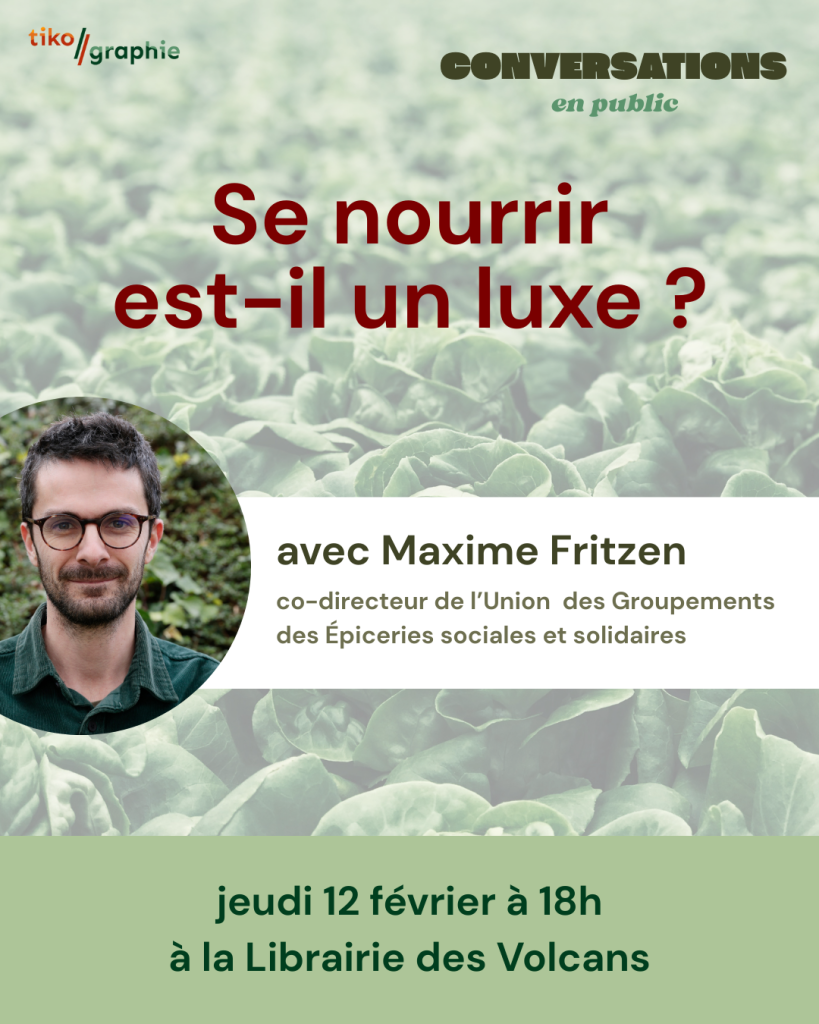Tikographie a besoin de vous
Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.
Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.
Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.
Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]
Haute Dordogne, jour 3. Aujourd’hui, on ajoute encore quelques chiffres spectaculaires, on explore les enjeux et l’historique du projet.
Quel nouvel éclairage en tirer ? Cette histoire de convergence des enjeux, qui montre la cohérence nécessaire des projets et des acteurs.
Ensuite, une fois de plus, la démonstration que pendant que les politiques en haut lieu détricotent les règlementations censées (au moins un peu) préserver l’environnement, sur le terrain, pour peu qu’il y ait des élus et autres institutions animés par la bonne volonté et la mutualisation des moyens, on continue d’avancer. Et pas qu’un peu.
Et enfin, qu’un grand projet ne signifie pas forcément un projet pharaonique. On arrête de bétonner. On intervient pour « effacer » les erreurs, humblement et avec légèreté.
N’est-ce pas réjouissant, tout ça ?
Mais attendez, ce n’est pas tout à fait terminé. Il reste encore un épisode…
Marie-Pierre
Trois infos express [cliquer pour dérouler]
- Le projet Dorsancy de renaturation et de valorisation de la Dordogne a été lancé dans le cadre du programme européen LIFE dédié à l’environnement. Il est doté au total de 14 millions d’euros et prévoit une intervention sur 7 ans, fédérant de nombreux acteurs.
- Il répond à des enjeux multiples et s’efforce de prendre en compte les aspects écologiques, mais aussi économiques, sociaux, environnementaux : une réorientation des trajectoires locales de développement du territoire pour une adaptation aux problématiques climatiques et environnementales, sans toutefois remettre en cause complètement le rythme du questionnement sur l’activité autour des sports d’hiver, locomotive économique de la vallée.
- Né de différentes études et travaux de prospective remontant à la période d’avant covid, dont une sur le barrage de La Bourboule faisant l’objet de critiques et inquiétudes, le projet s’oriente le plus possible vers une approche de solutions fondées sur la nature, qui déconstruisent des ouvrages et s’en remettent à la résilience des milieux naturels pour rétablir des équilibres écologiques.
| Articles précédents : « Haute-Dordogne #1 : une rivière sous contrainte » et « Haute-Dordogne #2 : chantiers en cascade » |
Un projet sur 7 ans, pour 14 millions d’euros.
Ces deux chiffres pourraient à eux seuls résumer ce qui se prépare pour la haute vallée de la Dordogne. Après un siècle où elle a suivi le mouvement de canalisation, d’endiguement, d’enfouissement, en un mot de maîtrise de la rivière, puis quelques décennies de… rien, les instances locales, régionales et même européennes se penchent sur la situation de ce petit bout du territoire puydômois et ont décidé de ne pas faire les choses à moitié.
« On a ici des enjeux humains, économiques, touristiques qui s’ajoutent à ceux des milieux naturels et du changement climatique. »
On a détaillé dans l’article précédent les travaux prévus sur la rivière elle-même, à travers la série de chantiers qui vont s’étager depuis les sources de la rivière jusqu’au barrage de La Bourboule. Mais ils ne suffisent pas à rendre compte de l’ambition du projet Dorsancy, confirmé en 2024, et dont les prémices démarrent actuellement. Parce que, comme le résume Roland Thieleke, directeur d’Epidor, l’établissement public de gestion de la Dordogne, « on a ici des enjeux humains, économiques, touristiques qui s’ajoutent à ceux des milieux naturels et du changement climatique. »
Dorsancy est lancé dans le cadre du programme européen LIFE – pour « L’Instrument Européen pour l’Environnement » – l’unique fonds européen entièrement dédié, depuis 1992, à l’environnement. Il finance notamment la gestion des zones Natura 2000, mais surtout les projets pilotes et démonstrateurs autour de démarches d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.

Ambition maximale
Pilote, le projet pour la Haute Dordogne l’est à plus d’un titre. D’abord parce qu’il a fédéré, à divers degrés et dans différents rôles, un nombre impressionnant de partenaires pour constituer un projet cohérent. « L’idée était d’amener tout le territoire à réorienter les trajectoires en se basant sur les enjeux de la rivière, pour récupérer des espaces naturels », poursuit le directeur d’Epidor.

L’énoncé des cinq grands objectifs du projet en donne la mesure et cela vaut la peine de les énumérer tels qu’ils sont résumés dans le dossier Dorsancy. Car il s’agit de 1. adapter le territoire aux effets du changement climatique, par la réduction de l’exposition aux risques naturels, la protection de la biodiversité, l’amélioration du cadre de vie, la planification et l’aménagement durable du territoire ; 2. développer des solutions fondées sur la nature pour des territoires plus résilients, par la restauration de l’état morphologique de la rivière Dordogne, des continuités écologiques et des paysages associés, la production locale d’énergie renouvelable et décarbonée, le développement des mobilités douces et collectives, le soutien à la sobriété du territoire ; 3. réduire l’empreinte environnementale et climatique des activités, grâce à la sensibilisation des acteurs locaux au changement climatique, à la participation des populations, à l’augmentation de l’acceptation de mesures d’adaptation au changement climatique dans les politiques publiques ; 4. co-construire de nouvelles collaborations public-privé-civil avec la diffusion des résultats du projet, 5. développer des synergies avec d’autres territoires de moyenne montagne en France et en Europe par la diffusion des résultats du projet.
« L’idée était d’amener tout le territoire à réorienter les trajectoires en se basant sur les enjeux de la rivière. »
Autant dire qu’il coche toutes les cases : celles très concrètes d’un formulaire de financement européen pour l’environnement, comme celles plus métaphoriques de ce qu’on peut souhaiter pour nos territoires.
Roland Thieleke souligne : « Pour les programmes européens LIFE, il y a une grosse concurrence entre les projets et c’est un vrai défi d’y candidater. Mais même vu de l’Europe, celui-ci apparaît exceptionnel car il intègre non seulement ces problématiques diverses, mais en plus la transformation d’un barrage, ce qui reste rare : en général, on ne déconstruit pas un barrage. C’est aussi un projet très ambitieux du fait que peu de projets LIFE combinent les aspects liés aux espaces naturels et les questions d’aménagement urbain. »
| Pour découvrir une autre initiative liée à des programmes européens et concernant les villes d’eaux, lire aussi le reportage : « Comment les stations thermales anticipent leur adaptation » |
Convergence des enjeux
Comment un projet d’une telle ampleur a pu être mis sur pied ? L’idée a germé dans les années 2017-2018. « De notre côté, nous avions lancé deux études : l’une sur le périmètre des sources et l’autre sur le barrage de La Bourboule », explique Roland Thieleke. Ce barrage vieux de plus d’un siècle posait question depuis longtemps et avait été peu avant, en 2015 précisément, à l’origine d’un accident écologique sérieux. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait été un des facteurs déclenchants du projet.

À la même période, les élus locaux se posaient des questions similaires. Et Crystèle Maitre, secrétaire générale de la communauté de communes Massif du Sancy, souligne : « On réfléchissait à l’idée d’adapter le territoire au changement climatique et il y avait convergence des enjeux avec les questionnements d’Epidor. »
« Tout le monde était prêt. »
La conclusion des études poussait à la mise en œuvre d’un projet de territoire, qui s’inscrivait en cohérence avec le projet Dordogne 2050 : une réflexion prospective à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Dordogne, en concertation avec les territoires pour comprendre les fragilités démographiques, sociales, économiques, environnementales et pour bâtir un plan d’action autour de l’axe fédérateur de la Dordogne.
Ces différentes initiatives, à une époque où ces sujets étaient partout dans l’air du temps, avaient sensibilisé les parties prenantes à la nécessité d’agir pour « décorseter » le cours d’eau et en profiter pour poser toutes les questions sur l’avenir de ce territoire aux spécificités si particulières. La crise sanitaire du covid a à la fois freiné la mise en œuvre et renforcé la dynamique. Au sortir de la période des confinements, « tout le monde était prêt », résume Roland Thieleke.
Ensemble pour candidater
« C’est pourquoi il n’y a pas eu de réticences », complète Crystèle Maitre, qui ajoute : « C’est aussi parce que le projet ne va pas jusqu’à révolutionner l’organisation économique de la région. Les élus savent que l’enneigement se réduit et va finir par disparaître ; on ne fait pas de surinvestissement sur cette activité, mais on n’est pas encore prêts à abandonner l’économie du ski, car elle permet de financer le reste et elle fait vivre beaucoup de professionnels dont toute l’activité est centrée sur les sports d’hiver. L’intérêt du projet, c’est qu’il apporte de la naturalité mais reste compatible avec l’activité de la station. »
« Cette candidature européenne nous a tous boostés. »
La dynamique s’est donc enclenchée dans la période de l’après covid. En juin 2022, la communauté de communes Massif du Sancy, avec les communes du Mont-Dore et de La Bourboule, demandait officiellement à Epidor de coordonner la préparation de la candidature à l’appel à projets LIFE. « Cette candidature européenne nous a tous boostés », se souvient Crystèle Maitre.
Le premier projet déposé a été retoqué, mais ça n’a pas découragé les partenaires. Au contraire, ils se sont accordés pour le retravailler et lui donner une portée plus ambitieuse. Le nouveau dossier, déposé en septembre 2023, a été retenu et confirmé en 2024.
Solutions fondées sur la nature
Ce printemps 2025 marque le début de sa concrétisation. Un premier appel à projets vient d’être lancé pour la réalisation d’un inventaire complet de la faune, de la flore et des habitats. « Les relevés naturalistes seront réalisés sur les quatre saisons et fourniront un état des lieux des populations au point zéro du projet. Cela nous permettra d’effectuer un suivi de leur évolution », précise Roland Thieleke.
En parallèle seront lancées prochainement les études de conception des différents chantiers.
Puis viendra l’instruction règlementaire, avec les différentes étapes de concertation, les autorisations, les consultations publiques. « Le démarrage des chantiers proprement dits ne se fera pas avant la fin 2026, même plutôt en 2027, poursuit-il. Mais à partir de là, ça peut aller très vite. » Sans toutefois qu’il y ait nécessité à précipiter les choses, car le projet, commencé officiellement en septembre 2024, dispose de sept ans pour parvenir à son achèvement.

Cette dynamique est aussi exceptionnelle sur un dernier point : les collectivités ne se sont pas opposées à des méthodes peu conventionnelles dans le monde de la décision publique, comme le souligne le directeur d’Epidor : « On n’imagine pas les freins pour une telle approche de l’aménagement : pour beaucoup d’élus et d’aménageurs, encore aujourd’hui, tant qu’on ne met pas du béton et du métal, ce n’est pas un projet. Ici, on n’est plus dans l’aménagement ni même dans la réparation. Il s’agit de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature. On n’intervient qu’une fois, de façon relativement légère, pour déconstruire. Puis on laisse faire la nature. C’est une approche assez nouvelle et plus résiliente. »
La résilience passe enfin par une autre caractéristique de Dorsancy, qui est de réunir de nombreux acteurs du territoire dans toute leur diversité. Et c’est ce que nous découvrirons dans un dernier épisode, qui ne sera pas le moins réjouissant !
| Prochain article : « Haute-Dordogne #4 : un territoire groupé autour de sa rivière » |
Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé le mercredi 9 avril 2025 (complété ensuite par divers entretiens). Photos Marie-Pierre Demarty. À la une : le bourg du Mont-Dore avec le Sancy en arrière-plan
La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail
Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.